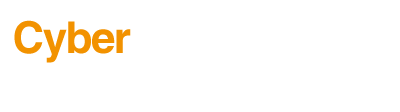Les réflexions autour du télétravail sont apparues dès les années 1980 et ont été notamment théorisées par le rapport Breton en 1993. Ces réflexions ont évolué avec le développement des technologies de l’information et de la communication, la notion de télétravail s’étant beaucoup nuancée et diversifiée.
Introduction
Tout d’abord, l’évolution technologique et des prix. Le développement de l’équipement informatique des foyers, des accès à haut débit et des technologies sans fil permet une dissémination croissante des applications intégrées, facilitant le travail coopératif et le travail à distance. Plus de 43% des foyers ont aujourd’hui un ordinateur contre 36% en 2002 ; la France a doublé en un an le nombre d’abonnés au haut débit, le portant à 6 millions fin 2004 ; 95%, enfin, des entreprises sont aujourd’hui connectées. Ces nouveaux outils permettent de travailler à distance de manière plus confortable et en dehors des locaux habituels de l’entreprise.
Ensuite, en raison des évolutions économiques et organisationnelles des entreprises. Ces dernières font face, de plus en plus, à un environnement très concurrentiel, au plan national ou international, qui leur impose des adaptations, voire des restructurations permanentes. Dans un tel contexte, le travail à distance peut apparaître comme une des solutions permettant de répondre avec souplesse à cette obligation constante d’ajustement, un des outils de flexibilité, permettant, par exemple, de gérer une réorganisation géographique en conservant des compétences au sein de l’entreprise.
L’évolution des mentalités est également un des facteurs de croissance du travail à distance. Si les « trente Glorieuses » ont consacré le travail se déroulant presque entièrement au sein de la même entreprise, les années récentes ont illustré la fragilité des carrières individuelles et les risques de perte d’emploi. Ces difficultés de nature « économiques » se conjuguent à une réorientation croissante des individus et des valeurs vers la sphère individuelle. Ces éléments conduisent certains salariés à une recherche plus forte d’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Exercer une activité professionnelle ne se déroulant plus exclusivement au sein du lieu de travail traditionnel peut répondre à cette aspiration, notamment pour les plus jeunes salariés.
La dernière raison est celle liée à une actualité sociale significative : le 16 juillet 2002 a été signé par le CES, l’UNICE/UEAPME et le CEEP un accord-cadre européen sur le télétravail. Cette signature est la première expression d’un véritable accord entre partenaires sociaux au niveau européen[1] et, même s’il ne présente pas de caractère juridique contraignant, il incite les partenaires sociaux, au plan national, à réfléchir sur les règles à adopter.
La conjonction de ces différents éléments entraîne un développement du télétravail qui concerne de plus en plus d’entreprises et de salariés. Le télétravail change ainsi d’échelle et de nature. Si, jusqu’à présent, il est encore traditionnellement développé au sein de certaines entreprises et réservé à certaines catégories de salariés, en particulier les cadres, on peut néanmoins faire l’hypothèse qu’avec l’actuel déploiement des TIC, tant au sein des entreprises que chez les particuliers, le télétravail tendra à se développer dans de nombreux secteurs d’activité et concernera de plus en plus l’ensemble des catégories de salariés.
Or, si les entreprises et les salariés perçoivent les opportunités de ce développement, ils en ignorent souvent les difficultés, voire les risques. Le télétravail se développe en effet souvent de manière spontanée ce qui peut créer des inconvénients réels pour l’ensemble des acteurs.
L’enjeu est donc de mettre en place un environnement de confiance permettant de valoriser, pour les entreprises comme pour les salariés, les opportunités liées au télétravail. C’est l’objet de la mission confiée, le 28 juillet 2003, par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité au Forum des droits sur l’internet.
Méthodologie suivie
Le Forum des droits sur l’internet a composé un groupe de travail inter-disciplinaire, constitué de juristes, sociologues, praticiens du télétravail au sein des entreprises et de représentants des administrations concernées (liste des membres en annexe).
Le groupe de travail a procédé, en complément de ses séances de travail collectif, à des auditions de personnalités désignées pour leurs connaissances et leurs expériences des enjeux relatifs au télétravail mais aussi d’entreprises, de collectivités locales ou encore d’organismes publics ayant ou souhaitant mettre en place cette forme d’organisation du travail.
Parallèlement à ces auditions, le groupe de travail a souhaité élargir le domaine des consultations et expériences. Pour cela le Forum a mis en place, sur son site internet, un appel à témoignages(synthèse des contributions en annexe).
Enfin, une comparaison internationale a été menée à travers une demande de contributions faite aux services sociaux de nos ambassades.
Le rôle des partenaires sociaux
Une négociation collective doit prochainement s’ouvrir entre les partenaires sociaux pour transposer l’accord-cadre européen sur le télétravail. Cet accord est le premier à être mis en œuvre par la voie volontaire visée à l’article 139 du Traité sur l’Union européenne. Il ne débouche pas ainsi sur une directive devant être transposée en droit interne par les Etats mais sur un accord collectif qui sera mis en oeuvre selon les procédures et pratiques spécifiques aux partenaires sociaux nationaux.
Les travaux du groupe n’ont évidemment pas pour intention de se substituer à cette négociation ni d’en préempter les résultats. La négociation va se dérouler selon le calendrier et les modalités que les partenaires sociaux fixeront. Les recommandations émises n’ont comme objectif que de présenter des pistes de réflexion à même d’éclairer utilement tous les acteurs.
Dans cette perspective, le groupe a tenu à associer les partenaires sociaux à ses réflexions. Les différentes organisations professionnelles et syndicales ont ainsi été auditionnées et ont pu réagir sur les différentes propositions formulées.
Champ de l’étude
A titre liminaire, le groupe de travail s’est intéressé à la terminologie employée. La lettre de mission fait référence au terme de « e-travail » or les nombreuses auditions ont montré que la signification de ce mot était controversée. Elle semble viser tout travail organisé autour d’un réseau fonctionnant à l’aide des technologies de l’information et englober ainsi l’ensemble des modifications qu’entraîne l’apparition des nouvelles technologies dans l’entreprise. Or, le groupe de travail a souhaité mener une réflexion sur les seules modalités de travail distant qu’autorisent les nouvelles technologies. Par ailleurs, l’ensemble des interlocuteurs rencontrés utilise le terme de « télétravail », qui correspond à celui de l’accord-cadre européen signé sur le sujet.
En conséquence, le groupe de travail a préféré utiliser le terme de télétravail plutôt que celui de e-travail.
En outre, le groupe de travail a souhaité préciser sa définition du télétravail afin de circonscrire le champ de ses réflexions.
L’accord-cadre européen sur le télétravail définit le télétravail comme « une forme d’organisation du travail et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l’information, dans le cadre d’un contrat ou d’une relation d’emploi, dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière »[2].
Des définitions plus larges ont pu être retenues. Ainsi, le projet européen EMERGENCE dont l’objectif était de cerner le e-travail et qui s’est intéressé aux pratiques des entreprises installées en Europe, a défini le e-travail comme « tout type de travail qui fait usage d’outils de traitement de l’information et de télécommunications pour en livrer le produit à un employeur ou un client distant ».
Le groupe de travail, quant à lui, estime que le télétravail peut être défini comme étant le travail qui s’effectue, dans le cadre d’un contrat de travail, au domicile ou à distance de l’environnement hiérarchique et de l’équipe du travailleur à l’aide des technologies de l’information et de la communication.
Le groupe de travail a donc volontairement inscrit sa réflexion dans le cadre du salariat. Certes, le travail à distance peut également prendre la forme d’un travail indépendant dans lequel les technologies de l’information facilitent le contact entre le donneur d’ordres et son prestataire. Mais il lui a semblé que ce n’étaient pas les seules nouvelles technologies qui devaient susciter une évolution des modes d’emploi, lesquelles relèvent des choix de l’entreprise. C’est pourquoi, les travaux du groupe ont été menés dans le cadre d’une relation de travail inchangée.
Le rapport a été soumis à l’ensemble des membres du Forum des droits sur l’internet et adopté par le Conseil d’orientation du Forum dans sa séance du 22 novembre 2004.
Plan du rapport
Afin d’informer les entreprises et leurs salariés, le présent rapport dresse un état des lieux des pratiques de télétravail en France et à l’étranger ainsi que le profil du télétravailleur français (I).
Ces pratiques permettent de se rendre compte des potentialités qu’offre le télétravail mais aussi des actuelles interrogations qu’il suscite tant auprès des salariés que des employeurs (II).
Le Forum a souhaité répondre à de telles interrogations en proposant un environnement de confiance à même de favoriser le développement du télétravail en France (III).
I.- LE TELETRAVAIL : ETAT DES LIEUX
|
|
A.- Des formes très différentes de télétravail salarié
Les auditions ont montré que quatre formes différentes de télétravail salarié existent.
1.- Le télétravail en réseau au sein de l’entreprise dans des locaux géographiques distincts
Dans ce cas de figure, le salarié est localisé dans un site géographique mais il relève d’un manager localisé dans un autre site, voire travaille dans une équipe relevant d’un autre site. Les nouveaux outils techniques (réseau intranet, messagerie, agenda partagé, groupware) permettent la formation d’une équipe virtuelle établie sur différents sites.
Cette évolution peut se faire de deux manières.
Dans certains cas, le télétravail s’organise dans des locaux géographiques qui ne sont pas dédiés à cet effet. Certaines entreprises permettent ainsi à certains salariés de rester dans leurs locaux traditionnels tout en travaillant sous le contrôle d’une hiérarchie et avec une équipe installée dans un autre site de l’entreprise. Une telle solution permet ainsi de réorganiser l’entreprise sans imposer un déménagement des salariés. Elle offre également une réponse adaptée et souple aux désirs de localisation de certains salariés.
Dans d’autres cas, le télétravail se met en place dans des locaux dédiés à cet effet. Certaines entreprises ont ainsi mis en place des centres de proximités pour leurs salariés autour de Paris. Ce choix est inspiré par la volonté de limiter les temps de trajet des salariés et de rationaliser les investissements immobiliers de l’entreprise. Il apparaît ainsi plus efficient de prévoir des sites répartis dans la périphérie parisienne pour des populations commerciales amenées à se déplacer pour aller à la rencontre de leurs clients.
Une telle organisation ne modifie pas fondamentalement le lien qui existe entre le salarié et l’entreprise. Elle a, en revanche, une incidence réelle en terme d’organisation des équipes de travail et de management.
2.- Le télétravail dans des locaux partagés par plusieurs entreprises
Dans ce cas de figure, le salarié de l’entreprise travaille à distance de son équipe dans des télécentres où sont également présents des salariés d’autres entreprises. Il y dispose d’un poste de travail à partir duquel il peut aisément communiquer avec son entreprise.
Une telle organisation peut créer un sentiment de plus grande distance entre l’entreprise et le salarié. Celui-ci peut se sentir moins intégré au sein de son équipe, voire de l’entreprise elle-même, puisqu’il ne travaille plus au sein de ses locaux. En revanche, elle ne modifie pas en profondeur la relation du salarié au travail. Celle-ci continue de se réaliser dans un temps et un lieu déterminé, distinct de la vie privée du salarié.
3.- Le télétravail nomade
Tout en conservant un poste de travail physique au sein de l’entreprise, le salarié peut utiliser les technologies de l’information et les outils de travail mobiles pour travailler depuis n’importe quel lieu. Ceci a comme incidence de « nomadiser » le travail de nombreux salariés, qui, jusque là, était considéré comme ne pouvant s’exercer que dans les locaux de l’entreprise.
Néanmoins, pour certaines catégories de salariés, il ne s’agit pas d’une forme de travail inédite. Les commerciaux ou les agents techniques d’intervention ont toujours pratiqué le travail nomade. Pour ces métiers, les technologies de l’information ne font que faciliter ces formes de travail et le contact avec l’entreprise.
Cependant, tous les salariés ne perçoivent pas le développement de ces nouveaux outils comme une évolution neutre pour l’organisation du travail. En effet, les nouvelles technologies peuvent entraîner un contrôle plus approfondi de l’employeur par l’utilisation des fonctionnalités des nouveaux outils (par exemple en permettant la géolocalisation des intervenants). Cette mobilité peut également entraîner une distension du lien avec l’entreprise en rendant moins nécessaire le passage dans ses locaux puisque certaines tâches qui devaient auparavant s’effectuer sur le lieu de travail peuvent maintenant être réalisées n’importe où. Il en va ainsi, par exemple, des commerciaux qui rédigent directement leurs comptes-rendus sur leur ordinateur portable pour les expédier par courrier électronique à leur entreprise. Ils passeront donc moins de temps au sein des locaux communs.
4.- Le télétravail à domicile
Le salarié peut travailler à domicile grâce aux nouvelles technologies puisqu’il peut avoir accès plus facilement à son environnement de travail.
Les auditions ont néanmoins montré qu’il convient de distinguer clairement trois situations.
En premier lieu, le télétravailleur peut travailler de façon exclusive à son domicile ; ceci de façon permanente ou pour une période de temps limitée (par exemple pour s’occuper d’une personne malade). Le télétravailleur pourra passer de manière ponctuelle dans les locaux de l’entreprise lorsqu’il est salarié ou bien rencontrer des clients. Mais son lieu de travail sera de manière prédominante son domicile.
En deuxième lieu, le travail peut s’effectuer en partie à domicile. Dans ce cas, le télétravailleur conserve un lien plus important avec son environnement de travail en alternant une présence domicile/bureau. Dans la plupart des expériences mentionnées lors des auditions, le télétravail s’organise autour de cette deuxième modalité, le salarié ne travaillant à son domicile que deux ou trois jours par semaine ; le reste du temps, il travaille dans les locaux de l’entreprise. Cette forme de travail a souvent été appelée travail » télépendulaire « , en alternance dans les locaux de l’entreprise et à domicile.
Enfin, certaines sociétés sont organisées entièrement autour du télétravail à domicile. Ainsi, lors d’une des auditions, une entreprise a indiqué au groupe de travail qu’elle ne possédait pas de locaux ; les réunions ayant lieu dans des salles louées pour l’occasion. La plupart des réunions restaient virtuelles (avec audio et partage d’applications) ; l’ensemble des salariés ayant été recruté dès l’origine pour ne travailler qu’à domicile.
B.- Le télétravail en France se développe lentement et de manière différenciée
Jusqu’à présent, il n’existait pas d’évaluation chiffrée et détaillée sur le télétravail en France. Les seules données provenaient d’études globales sur le travail distant menées à l’échelle européenne. C’est pourquoi le Forum des droits sur l’internet a souhaité qu’une étude approfondie sur le télétravail soit conduite, pour la première fois, en France. Pour ce faire le Forum a demandé à la Dares (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques) du ministère du travail de cerner statistiquement la population des télétravailleurs français[3] (l’étude complète figure en annexe).
1.- La progression du télétravail en France est lente mais régulière
L’étude demandée par le Forum des droits sur l’internet à la Dares permet d’estimer le nombre de télétravailleurs en France à 7% de la population active salarié. Parmi cette population, le télétravail à domicile concerne 2% des salariés (soit 440.000 personnes) et le télétravail nomade 5% (soit 1.100.000 personnes).
Ces chiffres permettent de constater que la progression du télétravail en France est lente mais régulière. Les données chiffrées provenant des études européennes estimaient en effet qu’en 2003 la France comptait environ 6% de télétravailleurs[4] et en 2001 5,6%[5].
2.- Le télétravail se développe dans un cadre largement informel
Les auditions et travaux menés par le Forum permettent de constater que le télétravail se pratique en France dans un cadre encore largement informel. En effet, le télétravail se met souvent en place de façon ponctuelle pour répondre à des situations individuelles. En s’organisant ainsi de manière spontanée, le télétravail n’est que rarement formalisé par un contrat de travail en bonne et due forme.
3.- Un phénomène qui concerne aujourd’hui surtout les » cols blancs «
Il est difficile de dresser un profil type du télétravailleur car, comme on l’a vu, il existe différentes formes de télétravail. L’étude susmentionnée a néanmoins permis de dégager un certain nombre d’indications. Six caractéristiques principales peuvent se dégager.
a.- Les télétravailleurs sont principalement des cadres
Le télétravail concerne essentiellement des salariés qualifiés. Ainsi, pratiquement aucun ouvrier et peu d’employés peuvent être considérés comme des télétravailleurs.
Près de la moitié des télétravailleurs à domicile sont des ingénieurs ou des cadres et pour un tiers des professions intermédiaires. Ainsi, 10% des cadres peuvent être considérés comme des télétravailleurs à domicile (4% fixes, 6% alternants), mais seulement 2% des professions intermédiaires (respectivement 1% et 1%).
Le télétravail nomade concerne encore plus les salariés qualifiés puisque la moitié de ces télétravailleurs sont des ingénieurs ou cadres, et un cinquième seulement appartiennent à des professions intermédiaires. Le télétravail nomade est pratiqué par 20% des cadres, 9% des professions intermédiaires et 3% des employés.
b.- Les télétravailleurs sont surtout des hommes
Les femmes sont minoritaires parmi les télétravailleurs : elles représentent 43% des télétravailleurs à domicile (soit deux points de moins que leur part dans la population salariée). Il convient de noter que la probabilité qu’une femme soit télétravailleuse à domicile ne dépend pas du fait qu’elle aie des enfants ni du nombre d’enfants, ce qui contredit l’hypothèse, parfois avancée, selon laquelle le télétravail serait favorisé par le souhait des femmes de pouvoir mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.
c.- Les télétravailleurs nomades sont majoritairement en CDI à temps plein
Les télétravailleurs nomades sont plus souvent en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein (90%) que l’ensemble des salariés en France (74%). En revanche, en ce qui concerne les télétravailleurs à domicile, on ne peut faire de lien entre le statut de l’emploi et le recours au télétravail. En effet, ils peuvent tout autant être en CDI à temps plein ou a temps partiel qu’en contrat précaire (contrat à durée déterminée ou intérim).
d.- Les télétravailleurs exercent principalement dans le secteur financier et les services aux entreprises
Deux secteurs se distinguent par une utilisation plus intensive du télétravail : le secteur financier (banques et assurances), avec 3% de télétravailleurs à domicile et 9% de télétravailleurs nomades ; et surtout les services aux entreprises, qui comptent 4% de télétravailleurs à domicile et 16% de télétravailleurs nomades. Du fait de leur relativement faible proportion de cadres, le BTP, le commerce, les services aux particuliers et les transports sont nettement en retrait ; l’industrie et l’administration se situent dans la moyenne.
e.- Les télétravailleurs bénéficient d’horaires plus souples mais aussi plus longs
Les télétravailleurs ont des horaires plus souples. Ainsi, chez les cadres, 57% des télétravailleurs à domicile et 53% des télétravailleurs nomades déterminent librement leurs horaires de travail, contre 35% des cadres ordinaires. Il convient néanmoins de noter que cette liberté s’accompagne souvent de débordements du travail sur le temps familial. Les télétravailleurs sont beaucoup plus nombreux à signaler travailler la nuit, le samedi ou le dimanche. Les plus concernés sont les salariés travaillant en partie à domicile : 20% d’entre eux signalent travailler » habituellement » la nuit[6] (contre 10% des autres salariés).
f.- Les télétravailleurs sont bien insérés dans leur emploi
Les télétravailleurs sont bien insérés dans leur entreprise ou leur collectif de travail (cf. ils sont le plus souvent en CDI à temps plein). Ils sont ainsi plus nombreux que les autres salariés à avoir reçu une formation au cours des douze derniers mois (par exemple, 47% des nomades contre 28% des salariés ordinaires). De plus, il semble qu’ils ne souffrent pas non plus d’un isolement social particulier : les salariés travaillant en partie à domicile signalent plus souvent (63%) fréquenter des collègues hors du travail que les autres salariés (52%). Enfin, les auditions ont montré que cette bonne insertion peut également s’expliquer par le fait que le télétravail est le plus souvent fondé sur du volontariat et concerne davantage les salariés ayant de l’ancienneté.
4.- Quelques entreprises pilotes
Le télétravail est formellement mis en place au sein de quelques grandes entreprises dans des secteurs bien déterminés
La mise en place » formelle » du télétravail est surtout le fait de quelques entreprises de taille importante et dépendant majoritairement de secteurs bien identifiés tels que les services aux entreprises, les télécoms ou encore l’informatique. Parmi ces entreprises on peut, par exemple, citer EDF-GDF, IBM France, France Télécom ou encore Accenture France. Ces entreprises ont formalisé la mise en place du télétravail par le biais de charte ou d’avenant au contrat de travail.
EDF et GDF ont, dans le cadre d’une concertation avec les représentants des fédérations syndicales, élaboré un référentiel d’Entreprise (juillet 2001) intitulé « Principes applicables au télétravail dans les Unités d’EDF et Gaz de France« . Ce référentiel reconnaît l’utilisation du télétravail comme mode d’organisation et comme une réponse possible aux besoins permanents d’adaptation et à la gestion des multiples implantations locales. De plus, une » Convention de mise en télétravail » a été instaurée ; elle comporte les conditions d’exercice du télétravail[7] (durée, lieu, conditions matérielles, etc.).
Le développement du télétravail à EDF et Gaz de France est associé à de nombreux enjeux allant de l’amélioration des performances et la réduction des coûts à l’innovation sociale (diminution des temps de trajets, amélioration des conditions de vie des personnels, responsabilisation et autonomie) en passant par la recherche de l’intérêt général (aménagement du territoire, développement économique local, environnement). Pour EDF-GDF, la particularité du télétravail réside d’ailleurs dans cette recherche d’équilibre entre intérêts particuliers et intérêt général, qui permet de mutualiser les ressources et de répondre au plus près aux besoins des agents, tout en accroissant les rendements.
IBM France a mis en place depuis 1999 un » Programme Mobilité » qui donne la possibilité de travailler de un à trois jours par semaine dans un site dit de proximité. Le site de proximité est une solution intermédiaire entre le tout télétravail à domicile et le travail traditionnel en entreprise. Cette initiative, dont les réflexions ont démarrées dès 1994, était prise parce qu’IBM souhaitait optimiser son parc immobilier dont les coûts vont croissants et que les employés demandaient à améliorer leur ratio vie privée/vie professionnelle en réduisant les temps de transports.
La mise en place du programme Mobilité a été formalisée par l’édiction d’une » Charte de la Mobilité « . Elle rappelle les règles de bonne conduite à tenir pour respecter la vie privée des collaborateurs, leur charge de travail ou encore la réversibilité du télétravail. De plus, un modèle d’échange de courrier interne formalise le passage à la mobilité en rappelant, en particulier, la limite des trois jours par semaine hors du bureau.
IBM France a estimé que le bilan est positif[8] mais que le télétravail suppose un changement des mentalités et que les employés aient une grande autonomie dans leur travail. Il est en effet nécessaire que leur supérieur hiérarchique leur fasse confiance et que cette confiance soit réciproque ; ce qui sous-entend une évolution des mentalités et des cultures. Enfin, IBM France estime que, pour que ce système s’implante, il faut que les lieux de proximité soient attractifs pour compenser la tendance naturelle qui consiste à aller auprès des collègues et des managers. C’est pourquoi dans chacun de ces sites se trouve un secrétaire d’accueil ou encore des restaurants ou des parkings.
France Télécom a créé dès 1997 une Direction de Projet Télétravail au sein de la Direction de l’Innovation et des Nouveaux Usages, en 2002 cette direction a été confiée à la Direction des ressources humaines[9].
Des bénéfices liés au télétravail ont été constatés tant par les salariés que par la direction. Les salariés estiment bénéficier de gain de temps (en ne repassant pas au bureau notamment) et d’une meilleure gestion de leur travail (possibilité de travailler en différé). Pour la direction, les salariés sont plus réactifs (réponse quasi-instantanée aux courriels) et plus productifs (plus de rendez-vous par jour). Enfin, le télétravail permet également d’économiser des mètres carrés de bureau.
Dès 1997, les aspects juridiques du télétravail ont été abordés, avec l’élaboration d’un cadre juridique pour le travail à domicile (alterné principalement) destiné à préciser les obligations réciproques des salariés, de leur encadrement et de l’entreprise. Ce cadre juridique se traduit par un avenant au contrat de travail ou » Protocole d’accord de télétravail » co-signé entre le salarié et son manager.
Accenture France a mis en place un programme de télétravail en 2002 (projet » Great Place To Work « ). Ce projet, fondé sur le volontariat, prévoit notamment qu’il ne peut y avoir de télétravail à temps plein, le maximum autorisé étant de deux jours par semaine ; ces jours doivent être choisis d’un commun accord avec la hiérarchie.
Les salariés souhaitant télétravailler signent un avenant au contrat, nommé » Avenant pour le télétravail « , dans lequel les conditions du télétravail sont prévues.
Sur les 3200 salariés d’Accenture France, on ne compte qu’une cinquantaine de télétravailleurs. Les métiers concernés (outre quelques consultants) sont plus particulièrement les fonctions de support tels que les documentalistes, juristes ou encore les contrôleurs de gestion. De fait, le télétravail est le plus souvent pratiqué pour faciliter une reprise d’activité » en douceur » (maternité, longue maladie…).
Quelques PME sont allées plus loin et se sont organisées entièrement autour du télétravail, sans bureaux. C’est le cas, par exemple, de la société Mayetic, éditrice de logiciels et spécialisée en espaces de travail collaboratifs où les 25 salariés travaillent entièrement à leur domicile.
5.- Une quasi-absence du secteur public
a.- En tant qu’employeur
L’administration n’a pas souhaité développer une politique de télétravail volontaire pour ses propres services qui aurait pu être à l’origine d’une dynamique plus large. Ainsi, les exemples de télétravail réalisés au sein de la fonction publique sont rares (Rectorat de l’Académie de Bordeaux, Office National du Lait, Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé principalement) et le plus souvent menés à l’initiative des agents eux-mêmes.
On peut néanmoins noter l’élaboration d’un guide d’information sur le télétravail au sein de la fonction publique élaboré par la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique ainsi que l’existence des protocoles d’accord sur le télétravail à domicile[10].
b.- En tant que politique publique
Le rôle des pouvoirs publics dans le développement du télétravail apparaît relativement faible. En effet, il n’y a pas eu de politique globale en faveur du télétravail. L’action des pouvoirs publics a été essentiellement menée dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire. Des projets visant à soutenir le développement économique et la compétitivité des territoires sont apparus en effet dans les années 1990 avec la volonté de développer les télécentres. Ils n’ont cependant eu qu’un succès relatif. En effet, il n’avait pas été suffisamment pris en compte le fait que le télétravail est avant tout un outil au service de la stratégie et de l’organisation de l’entreprise. L’appel à projets télécentres, récemment lancé par la DATAR, devrait néanmoins s’inscrire dans cette perspective et apporter un soutien effectif aux territoires[11].
C.- Le développement international du télétravail
A l’initiative du Forum des droits sur l’internet, et dans le cadre de la lettre de mission, une enquête a été menée par les conseillers sociaux et les missions économiques situés au sein des pays de l’Union Européenne ainsi qu’aux Etats-Unis, Canada et Japon. Cette enquête permet de replacer la situation française dans un contexte plus large.
Les résultats permettent ainsi de constater que, contrairement à une idée reçue, les Français ne télétravaillent pas moins que nombre de leurs voisins européens. En effet, le taux de télétravailleurs en France se situe dans une moyenne haute au côté de l’Allemagne et du Royaume-Uni ; les pays scandinaves ayant une pratique du télétravail plus développée. En revanche, un certain nombre de partenaires sociaux européens ont déjà négocié la transposition de l’accord-cadre et la plupart des pays européens mènent des politiques publiques plus dynamiques en faveur du télétravail.
1.- Des pratiques de télétravail différentes selon les pays
Il convient, à titre liminaire, de considérer avec prudence les chiffres disponibles sur le télétravail. Ces chiffres proviennent souvent de sondages plus ou moins fiables ou ne sont pas actualisés. En outre, rares sont les pays qui ont réellement mis en place un système statistique permettant de mesurer le télétravail, terme qui est de plus défini selon des bases et des concepts différents selon les pays.
Les données de l’enquête permettent néanmoins de se faire une idée de l’état du télétravail au sein des ces différents pays.
Il n’y a pas de définition légale du télétravail au Royaume Uni. Le télétravail est considéré par les pouvoirs publics comme une « méthode de travail » utilisant des technologies informatiques pour permettre aux gens d’exercer leur emploi loin d’un environnement traditionnel de travail. La seule enquête officielle sur le télétravail a été réalisée par le ministère chargé des relations du travail et date du printemps 2001. Elle fournit néanmoins des informations assez détaillées sur la réalité du télétravail au Royaume Uni. A l’époque de l’enquête 2,2 millions de personnes pratiquaient le télétravail, soit 7,4% de la population active. Le nombre de télétravailleurs a ainsi augmenté d’environ 70% entre 1997 et 2001. Cette progression doit toutefois être relativisée puisqu’un récent sondage[12] estimait, qu’en 2004, le Royaume-Uni comptait 1,9 million de télétravailleurs, soit 6,9% de la population active salariée.
En Allemagne, le télétravail a été défini par les pouvoirs publics comme étant une « activité s’appuyant sur les technique de communication et d’information, qui s’exerce sous la forme d’une place de travail située totalement ou partiellement en dehors du lieu de l’entreprise. La place de travail est reliée à l’entreprise par un moyen de communication électronique« . Le nombre de télétravailleurs était estimé à 2,2 millions de personnes en 2003, soit 6,5% de la population active.
En Suède, le ministère suédois de l’Industrie, du Travail et des Communications estime que plus de 10 % de la population active, soit environ 450.000 personnes, travaillent » à distance » sur une base plus ou moins régulière. Ce chiffre apparaît stable depuis une dizaine d’années. Le télétravail concerne principalement les salariés qui travaillent en alternance au bureau et au domicile.
En Espagne, les seules données officiellement disponibles concernent les salariés travaillant dans le cadre d’un contrat de télétravail. Leur nombre est estimé à 27.500, soit 0,2% du nombre total de salariés. Par ailleurs, il est généralement avancé que 5% de la population active pourrait être considérée comme télétravailleurs au sens large du terme (salariés domicile et nomades mais aussi indépendants).
En Irlande, une enquête du Central Statistics Office réalisée en 2002 estimait à environ 40.000 le nombre de télétravailleurs à domicile, soit 2,3% de la population active[13]. Il convient de préciser que cette enquête excluait les télétravailleurs nomades.
En Autriche, le télétravail est compris comme étant comme du travail alterné domicile/bureau avec un à deux jours maximum de présence au domicile. Les seules statistiques concernant le télétravail proviennent d’un sondage effectué en 2002 où il était estimé que 3,9% des salariés étaient en télétravail alterné.
Aux Etats-Unis, on constate que les données officielles concernant le télétravail sont presque inexistantes et qu’elles ne concernent que le télétravail à domicile. La dernière enquête officielle date de 2001 : on estimait le nombre d’américains exerçant leur activité à domicile au moins une fois par mois à 25 millions, parmi lesquels 20 millions au moins une fois par semaine. En 2001, seulement 3,4 millions de salariés avaient conclu un accord formalisé avec leur employeur sur ce sujet soit environ 4% de la population active. Depuis, selon une étude menée en 2003 par un cabinet privé pour l’association américaine de télétravail, il était estimé que 24 millions de salariés et 23 millions de travailleurs indépendants auraient travaillé au moins une fois par mois à domicile.
Au Canada, en l’absence de statistiques officielles relatives au télétravail, des associations ont mené des études. Selon le Centre francophone d’informatisation des organisations (CEFRIO), le Canada est passé de 1993 à 2002 de 600.000 à 1,5 million de télétravailleurs. En 2001, le consultant canadien Ekos a mené un sondage qui estimait que 11% des canadiens travaillent principalement depuis leur domicile.
Au Japon, on estimait, en 2002, que quatre millions de personnes effectuaient plus de 8 heures de télétravail par semaine, soit 5,7% de la population active salariée. L’association » Japan Telework Association » estime que le nombre de télétravailleurs japonais sera de 4,5 millions en 2005. Le ministère du travail définit le télétravail comme une « méthode de travail qui, grâce à l’utilisation des moyens d’information et de télécommunication, n’est pas soumise à des conditions d’exercice liées au lieu et la durée du travail« .
2.- L’absence de cadre législatif particulier mais une mise en oeuvre fréquente de l’accord-cadre européen
Dans la plupart des pays concernés, il n’existe pas de cadre législatif particulier pour le télétravail. En revanche, certains pays se sont dotés de codes de bonne conduite, parfois inspirés de l’accord-cadre européen.
Ainsi, même si au Royaume-Uni il n’y a pas de cadre juridique spécifique du télétravail, le Gouvernement s’est engagé à ce que le télétravail suive les principes de l’accord-cadre européen. Il a ainsi publié en septembre 2003, conjointement avec le TUC (confédération des syndicats), le CBI (confédération des employeurs) et le CEEP UK (employeurs du secteur public), un guide de conseils concernant le télétravail. Ce guide[14] n’a pas de caractère réglementaire mais tire sa force de l’engagement des partenaires sociaux à le faire respecter. Il explique comment mettre en oeuvre l’accord-cadre dans le contexte britannique et constitue ainsi une référence, non obligatoire, pour les relations dans le cadre du télétravail.
De même en Irlande, un code de bonne conduite sur le télétravail a été élaboré et largement diffusé bien avant l’existence de l’accord-cadre.
En Allemagne, même s’il n’existe pas de contrat type pour le télétravail, les pouvoirs publics recommandent une liste d’éléments à prendre en considération lors de la négociation du contrat de travail. Ces éléments stipulent, entre autre, qu’il convient de préciser le début et la fin du télétravail, de réglementer les horaires de travail et la protection des données ou encore qu’il est possible d’abandonner le télétravail. En ce qui concerne l’accord-cadre, la Fédération allemande des employeurs (BDA) et la Confédération allemande des syndicats (DGB) ont fait une déclaration commune invitant les partenaires sociaux à la négociation et décidant son application. En pratique tous les secteurs sont visés, sous réserve que le travail s’y prête. Les salariés du secteur public et du secteur privé sont concernés.
En Suède, les partenaires sociaux ont signé une déclaration commune en mai 2003 recommandant que les fédérations et les entreprises utilisent l’accord-cadre européen pour favoriser le télétravail. Il revient ainsi aux fédérations et aux entreprises d’intégrer les éléments qu’ils souhaitent dans les conventions collectives déjà existantes. Les partenaires sociaux s’engagent à présenter aux syndicats européens concernés, d’ici le 31 décembre 2005, les mesures prises pour favoriser le télétravail au niveau des branches, des entreprises ou au sein des administrations.
Dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, les syndicats et le patronat ont également entamé le processus de mise en oeuvre de l’accord-cadre européen. En Italie, le texte de l’accord-cadre a été traduit et adopté en 2004. Au Danemark, pays pionnier en la matière, il n’a pas été estimé utile de transposer l’accord-cadre dans la mesure où celui-ci a été largement inspiré par les pratiques en vigueur dans ce pays.
Au Japon, le Ministère de la Santé et du Travail a récemment élaboré en mars 2003 un guide non impératif afin de clarifier la situation des télétravailleurs au regard de la loi en vigueur.
3.- Des interventions des pouvoirs publics plus actives qu’en France
En Irlande, les pouvoirs publics ont créé en 1998 le « National Advisory Council on Teleworking » (NACT) dans le but d’informer le public et de développer le télétravail. Le NACT a élaboré un » Code de pratique du télétravail « . Début 2004, le Gouvernement a mis en place des mesures pour le travail à domicile afin que les télétravailleurs puissent trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Pour ce faire il a été créé un Comité national dirigé par le ministère de l’entreprise, du commerce et de l’emploi.
En Allemagne il existe une forte volonté de la part des pouvoirs publics pour développer le télétravail. Depuis 1996, le Gouvernement fédéral a ainsi multiplié les programmes et initiatives en faveur du télétravail. Le programme » telearbeit « , lancé en 1996, concernait les applications liées aux nouvelles formes de travail apparues avec les TIC. De 1996 à 1999, le ministère de l’économie a mis au point un programme intitulé « telearbeit fuer den Mittelstand » (télétravail pour les PME) pour aider ces dernières à s’adapter aux nouvelles formes de travail. En 2001, une brochure intitulée « Le télétravail, guide pour la pratique d’un travail flexible« , a été diffusée par le ministère de l’économie. Depuis trois ans, toutefois, le télétravail ne constitue plus une priorité pour le gouvernement fédéral car il semble admis que le sujet est connu et banalisé.
Au Japon, le plan » e-Japan strategy 2 » , lancé en juillet 2003, prévoît notamment le développement du télétravail au Japon en vue de la » réalisation d’une société créative disposant de méthodes de travail variées « , l’objectif étant de porter la part des télétravailleurs à 20% de la population active d’ici 2010.
Certains pays ont développé une politique active d’accompagnement du télétravail dans la fonction publique. Au Canada, le Secrétariat du Conseil du Trésor, qui exerce le rôle d’employeur de la fonction publique fédérale, a instauré une » Politique de Télétravail » qui est entrée en vigueur le 9 décembre 1999. Les ministères ont l’obligation d’évaluer, à intervalles réguliers, la mise en œuvre de cette politique. Aux Etats-Unis, un programme ambitieux de télétravail a été mis en place dans les agences fédérales. L’organisme en charge de ce programme au sein de la fonction publique ( » General Services Administration « ) souhaite favoriser le développement du télétravail dans la fonction publique et l’implantation de télécentres.
II.- LE DEVELOPPEMENT DU TELETRAVAIL : POTENTIALITES ET INTERROGATIONS
|
|
En l’absence d’études sur l’impact du télétravail sur les entreprises et les employés, il se dégage néanmoins, au terme des auditions menées par le groupe de travail, les potentialités et les interrogations décrites ci-dessous.
A.- Le télétravail offre un certain nombre de potentialités
1.- Les potentialités pour les entreprises
a.- Le télétravail pourrait offrir des gains de productivité
Certaines entreprises ont montré que le télétravail à domicile peut engendrer des gains de productivité. Un télétravailleur à domicile bien intégré dans son équipe de travail apparaît plus productif (choix des plages horaires, organisation de son temps, concentration plus grande, réduction de l’absentéisme). De même, l’utilisation des technologies mobiles permettrait aux télétravailleurs nomades d’avoir une meilleure efficacité. Elle permettrait aux équipes commerciales ou aux équipes d’intervention technique d’avoir un respect plus strict des horaires, une prise de rendez-vous plus flexible et une réponse plus rapide aux besoins des clients. Le travailleur nomade peut également bénéficier en temps réel d’informations et avoir la possibilité de mettre en réseau des compétences dispersées sur le territoire pour lui offrir un service adapté.
Enfin, le télétravail offrirait une gestion plus souple de l’emploi en permettant à l’entreprise de faire face à des restructurations de locaux dictées par des impératifs de concurrence.
b.- Le télétravail permettrait des gains dans le domaine immobilier
Le télétravail pourrait également permettre des gains dans le domaine immobilier. Ce point est avéré chez IBM France où le développement de centres de proximité a permis de réduire le coût de l’immobilier d’entreprise, principalement dans des centres urbains congestionnés. Par ailleurs, de notables gains d’espace y ont ainsi été réalisés, peu de salariés ayant encore un bureau personnel attitré.
De même, la mise en place du télétravail pourrait logiquement permettre de faire travailler au sein d’une même équipe des experts maintenus en région au lieu de les regrouper à Paris, ce qui peut entraîner des gains d’espace importants.
c.- Le télétravail pourrait engendrer des gains d’ordre social
Le télétravail instauré de manière réfléchie et négociée pourrait contribuer au bien-être social de l’entreprise et influencer sa notation en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). Cette pratique, certes encore récente, devrait être appelée à se développer[15]. Dans cet esprit, la possibilité pour un salarié qui le désire de pouvoir exercer son activité en télétravail pourrait devenir un critère intéressant dans le cadre de la politique socio-environnementale de l’entreprise et, à ce titre, être intégrée dans le groupe des informations » sociales internes » de l’entreprise.
Le télétravail permettrait aussi de faire évoluer la culture managériale de l’entreprise en modifiant la mesure de l’activité du salarié. Avec cette nouvelle forme d’organisation du travail, le temps de travail devient un indicateur moins pertinent pour mesurer la contribution du salarié. Le télétravail permettrait ainsi de mettre en place de nouvelles formes d’évaluation des résultats en fonction des objectifs.
Offrir la possibilité de télétravailler, notamment à domicile, serait enfin une manière de montrer une image moderne de l’entreprise et ainsi d’attirer les compétences d’un nombre croissant de jeunes salariés soucieux de trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Les auditions menées par le Forum ont d’ailleurs montré que les jeunes diplômés sont sensibles à cet aspect au moment de l’embauche.
2.- Les potentialités pour les salariés
a.- Une meilleure qualité de vie
Le télétravail peut avoir comme avantage de permettre une autonomie dans le travail et la possibilité de travailler à son rythme. Dans ce cas, le télétravail apporterait au salarié une souplesse plus importante dans l’organisation de son travail (gestion autonome, choix des plages de travail…).
Le télétravail à domicile ou alterné permet, en général, de réduire les temps de transport entre le domicile et le lieu de travail, notamment dans les grands centres urbains. Ce gain de temps occasionnerait une diminution en conséquence non seulement des coûts de transports mais aussi du stress lié au retard éventuel. Cette diminution des temps de transport pourrait également influer sur l’habitat du télétravailleur. La diminution des trajets pourrait être l’occasion de choisir un logement plus éloigné du siège de l’entreprise offrant un espace plus important.
Enfin, le télétravail pourrait permettre au salarié de développer sa vie familiale, sociale ou associative et lui offrir une réponse adaptée si, pour des raisons personnelles, il doit être davantage présent à son domicile (pour s’occuper d’une personne âgée, d’un enfant…).
b.- Une adaptation aux changements de l’entreprise
Le télétravail semble également être une réponse appropriée à un changement de situation du salarié ; celui-ci pourrait s’adapter plus facilement à une réorganisation interne de l’entreprise. En effet, le salarié qui se verrait proposer une nouvelle affectation mais qui ne souhaiterait pas déménager pourrait profiter du télétravail, soit en travaillant à domicile de façon alternée, soit en travaillant dans un centre situé à proximité de chez lui.
c.- L’accès au travail des salariés handicapés
Enfin, le développement des technologies de l’information permettrait de faciliter l’accès au travail des personnes handicapées. En effet, le télétravail faciliterait l’adaptation du poste de travail suivant la nature ou l’évolution du handicap. Cette évolution du poste de travail qui n’impose plus la présence physique régulière du salarié sur le lieu de travail, ouvre de nouvelles possibilités en matière d’accès à l’emploi ou de création d’activité. Pour les personnes à mobilité réduite le télétravail à domicile devient alors souvent l’unique moyen d’accéder à une activité professionnelle. D’autres peuvent utiliser le télétravail alterné afin de conserver un lien social avec l’entreprise.
B.- Le télétravail suscite néanmoins des interrogations de la part des employeurs et des salariés
En dépit de ces avantages potentiels, le télétravail suscite encore des interrogations qui freinent son développement.
Avant de traiter des interrogations spécifiques de la part des employeurs et des salariés, il convient de rappeler qu’existent également des interrogations communes fondées sur des insécurités juridiques mais aussi sur un certain nombre de problèmes pratiques propres au télétravail.
1.- Les interrogations communes aux employeurs et aux salariés
Comme cela a été mentionné préalablement (cf. partie B. 2. « Le télétravail se développe dans un cadre largement informel« ), le télétravail en France se développe surtout de façon informelle. Le caractère spontané du travail distant soulève des interrogations de la part des employeurs et des salariés car des risques, résolus pour le travail classique au sein de l’entreprise, se reposent avec acuité.
a.- Le risque lié aux accidents du travail au domicile
L’accident du travail est l’accident survenu au temps et au lieu du travail. Il est, jusqu’à preuve contraire, réputé survenu par le fait et à l’occasion du travail. Dans ce cas, le salarié n’a pas à faire la preuve que la lésion dont il souffre est imputable au travail. Pour bénéficier d’une telle présomption la jurisprudence estime que le salarié doit être sous le contrôle de l’employeur.
La question se pose donc avec acuité pour le télétravail à domicile car l’employeur ne peut, en principe, y exercer son pouvoir de direction. Le salarié qui déclare un accident du travail au domicile devra ainsi faire la preuve que l’accident est imputable à l’activité professionnelle.
Dans ces conditions, le télétravailleur peut avoir l’impression qu’il se trouve dans une situation plus risquée que le salarié travaillant dans les locaux dans l’entreprise. De même, l’employeur peut, à juste titre, s’interroger sur la réalité de l’accident déclaré par le télétravailleur et avoir des difficultés à déterminer ce qui relève réellement de l’accident de travail.
b.- Le contrôle de la mesure du temps de travail
Avec le télétravail il devient souvent difficile pour l’employeur de déterminer avec précision le temps effectivement travaillé par le salarié. La question du contrôle de la mesure du temps de travail se pose donc régulièrement. En effet, l’employeur ne doit pas courir le risque d’être accusé de faire travailler le télétravailleur au-delà de ce que la loi autorise et le salarié doit pouvoir bénéficier de son temps de repos.
A cet égard il convient de rappeler que l’employeur court différents risques juridiques s’il ignore le respect des temps de repos. En effet, le salarié peut juridiquement faire valoir à l’encontre de son employeur un empiètement du travail commandé en dehors du temps et du lieu de travail. A cet égard, les technologies de l’information représentent un moyen de preuve très efficace pour le salarié. Elles lui permettent en effet de garder des traces de son activité (enregistrement du temps passé sur son ordinateur, temps de connexion à l’extranet de l’entreprise…). L’employeur peut ainsi se voir infliger des condamnations fortes pour non-paiement d’heures supplémentaires et ce parfois même à son insu puisqu’il peut arriver que le télétravailleur, de sa propre initiative, travaille en dehors des horaires prévus.
De son côté le salarié est également exposé au risque de devoir être constamment joignable par son employeur ce qui peut engendrer, de ce fait, une diminution de son temps de repos.
c.- L’utilisation de l’équipement
Dans le souci de protéger tant l’entreprise que le salarié des comportements abusifs, la mise en place du télétravail doit faire l’objet d’une attention particulière au niveau de l’utilisation de l’équipement professionnel par le télétravailleur et de son contrôle par l’employeur.
En effet, l’utilisation de l’équipement par un télétravailleur peut donner lieu à un grand nombre de litiges. Deux types de risques peuvent exister. Tout d’abord, les risques liés à une non clarification de la prise en charge des coûts d’équipements. Ensuite, ceux liés à l’utilisation illicite par le salarié du matériel fourni.
En premier lieu, des litiges liés à la prise en charge des coûts d’installation, de maintenance et d’utilisation de l’équipement peuvent fréquemment survenir. En effet, alors que la prise en charge de ces coûts est clairement assurée par l’entreprise dans ses locaux, le télétravailleur à domicile ou nomade pourrait se voir amener à supporter des coûts liés à son activité professionnelle si les modalités de prise en charge des frais ne sont pas clairement définies.
En second lieu, il est essentiel de déterminer clairement l’utilisation qui doit être faite de l’équipement mis à disposition. En effet, le problème de l’utilisation à des fins personnelles de l’équipement professionnel est souvent posé en raison du risque que peut représenter pour l’employeur l’utilisation de ce matériel à des fins illicites par le salarié. En effet, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, l’employeur, en tant que commettant de ses salariés, est responsable civilement des fautes commises par ceux-ci dans leur utilisation d’internet pendant le temps de travail. Certes, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité si le salarié agit hors des fonctions auxquelles il est employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions[16]. Toutefois, sa responsabilité peut être largement recherchée. Une attention particulière de la part de l’employeur s’impose donc. Le salarié, de son côté, doit s’engager à ne pas procéder de la sorte selon le principe visé à l’article L. 120-4 du code du travail selon lequel » le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi « .
En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut contrôler l’activité de ses salariés. Même s’il est normal que l’employeur cherche à garantir l’intégrité du système informatique de son entreprise et à veiller à ce qu’il ne soit pas fait une utilisation illicite du matériel fourni, il ne peut toutefois mettre en place des dispositifs de surveillance sans en informer les salariés, les institutions représentatives du personnel ainsi que la CNIL pour les traitements automatisés d’informations nominatives. S’il ne procédait pas ainsi, ces dispositifs seraient considérés comme clandestins et ne pourraient pas servir de preuve en matière civile.
2.- Les interrogations de la part des employeurs
a.- Comment conduire un projet de mobilité ?
Savoir conduire un projet de mobilité commence à devenir un enjeu majeur pour nombre d’entreprises. En effet, le marché professionnel de la mobilité connaît et continuera de connaître une expansion » soutenue » au cours des prochaines années. C’est du moins ce qui ressort d’une récente étude menée par le cabinet de conseil IDC[17]. Dans un contexte difficile pour l’ensemble du secteur informatique, IDC prévoit que le marché professionnel français de la mobilité devrait représenter en 2004 un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros, en croissance de 15% par rapport à 2003. Cette dynamique s’explique par la multiplication des terminaux mobiles et des services de transmission de données mobiles[18], mais aussi par la mise en mobilité de différentes applications comme la messagerie, les applications de gestion, les applications métiers, qui deviennent peu à peu un réel enjeu de compétitivité pour les entreprises.
Or, la mise en place d’un tel projet nécessite pour l’employeur de pouvoir en évaluer concrètement les bénéfices par le biais notamment d’un bilan coûts/avantages.
En effet, mettre en place du télétravail demande, pour l’entreprise, de réorganiser en profondeur sa façon de travailler. Les raisons du télétravail peuvent être diverses (réaffectation des postes ou réorganisation des services, gains d’espace, déménagement d’une partie des locaux de l’entreprise etc.) mais, dans tous les cas cette réorganisation occasionne des coûts de mise en œuvre non négligeables. Or, nombre d’entreprises ont souvent du mal à évaluer le retour de ces investissements. Ces difficultés expliquent notamment les raisons pour lesquelles la mobilité ne concerne encore aujourd’hui qu’une partie des salariés de l’entreprise, à savoir, prioritairement le management et les commerciaux (c’est-à-dire des salariés naturellement nomades).
De plus, la gestion d’un projet de mobilité à un impact important sur les processus métier ainsi que sur le management lui-même. Cet aspect est d’ailleurs précisé dans les rapports que le Cigref (Club informatique des grandes entreprises françaises) a publié en septembre 2004[19] sur les usages des technologies sans fil et sur la mobilité au sein des grandes entreprises. Il y apparaît que si la sécurité informatique reste une préoccupation majeure, les enjeux à venir portent notamment sur la capacité qu’auront les entreprises à mettre en place des outils permettant la mobilité et leur aptitude à conduire et accompagner de tels changements.
b.- Comment manager le télétravailleur ?
Les entreprises s’interrogent de plus en plus sur la façon dont il sera possible de manager le travailleur distant.
Ces interrogations sont d’autant plus présentes qu’un certain nombre d’employeurs souhaitent voir quotidiennement leurs collaborateurs. Le fait que nombre d’entre eux soient attachés à évaluer les compétences de leurs employés par une présence physique régulière ou encore que certains signes extérieurs montrant la position hiérarchique n’aient alors plus cours (le nombre de salariés de l’équipe physiquement présents ou l’espace occupé par un service) sont autant de freins au développement du télétravail.
De plus, les auditions ont montré que la présence physique apparaît essentielle non seulement pour l’entreprise mais aussi pour le télétravailleur. En effet, l’employeur peut certes craindre de ne pouvoir diriger efficacement un travailleur distant qui ne serait pas inséré dans son équipe mais le télétravailleur peut également craindre de perdre tout contact avec son organisation et de se trouver marginalisé (éloignement du manager et des collègues).
De plus, la mise en place du télétravail doit s’accompagner, pour l’entreprise, de certitudes en termes de management. Or, l’employeur ne va pas réorganiser son équipe s’il n’a pas la certitude à la fois de pouvoir, s’il le souhaite, mettre fin au télétravail à tout moment mais aussi que le télétravailleur ne va pas, au bout de quelques mois demander à retourner au même poste en entreprise.
En conséquence, la mise en place du télétravail doit s’accompagner d’une réflexion en profondeur sur les méthodes de management de l’équipe. Les managers de proximité devront apprendre à fixer des objectifs au télétravailleur, à lui faire confiance, à faire évoluer les modes de communication, à mesurer le temps de travail de façon différente (conventions de forfait ?…). Ce dernier point est d’ailleurs essentiel puisqu’avec le télétravail, le temps de travail n’est plus le seul indicateur référent pour mesurer la contribution du salarié.
c.- Comment gérer la sécurité du système informatique ?
Le télétravail nécessite un système d’informatique robuste et adapté. Pour ce faire l’entreprise devra savoir gérer les règles de confidentialité et les problèmes de sécurité et d’accès.
Le télétravail peut agir comme un révélateur des faiblesses éventuelles du système d’information de l’entreprise. Un certain nombre de managers auditionnés se sont particulièrement interrogés sur la sécurisation des données des travaux réalisés hors des locaux de l’entreprise ou encore sur la sûreté de leur transmission (le cas des » dossiers sensibles » par exemple chez Dassault Systèmes). Les risques sont en effet nombreux (déni de service[20], flooding[21], usurpation d’identité/spoofing[22], perte d’intégrité etc.). Les attaques répétées sur le système peuvent être lourdes de conséquences pour l’entreprise tant en termes financiers qu’en termes de compétitivité ou d’image.
C’est pourquoi, il est très important d’assurer une sécurisation du système. L’entreprise devra veiller au bon fonctionnement de ses outils de communication et mener une politique de sécurité portant notamment sur la confidentialité des données, l’intégrité des contenus, la disponibilité et la qualité du service. Pour ce faire, les entreprises pourraient, par exemple, mettre en place un réseau privé virtuel[23] (VPN, Virtual Private Network) qui serait de nature à réduire notablement les risques d’intrusion dans le système. Ce type de réseau comporte néanmoins des coûts de construction et d’exploitation non négligeables.
D’une manière générale, une sécurisation du système nécessite de repenser en profondeur l’architecture globale du système d’information de l’entreprise.
3.- Les interrogations de la part des salariés
a.- Comment éviter la rupture avec le collectif de travail ?
Le télétravail suppose une distance avec le collectif de travail qui pourrait faire craindre au télétravailleur une rupture d’égalité de traitement avec ses collègues non télétravailleurs. Cette rupture d’égalité interviendrait à tous niveaux : celui de l’équipement, de la formation, du déroulement de la carrière, de la stabilité de l’emploi ou encore d’accès aux institutions représentatives du personnel.
b.- Dans quelles mesures est-on apte à télétravailler et peut-on expérimenter cette forme de travail ?
Les expériences montrent que de nombreux salariés ne veulent pas télétravailler par crainte à la fois de ne pas savoir gérer un emploi en télétravail et de ne pouvoir retrouver, en cas d’échec ou de simple volonté de changement, leur précédent poste ou, à tout le moins, un emploi dans les locaux de l’entreprise.
Le télétravail suppose une autonomie beaucoup plus grande et une capacité à savoir gérer son temps. Le télétravailleur doit apprendre à organiser son travail à domicile, mais aussi loin de ses collègues ou de son responsable hiérarchique. Une telle approche n’est pas toujours simple à acquérir et demande souvent un changement de mentalité, un dialogue important avec sa hiérarchie mais aussi une compréhension de la part de l’entourage personnel et familial.
c.- Comment trouver un juste équilibre entre le temps professionnel et le temps personnel ?
Le télétravail suppose de trouver un juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle. En effet, avec le télétravail, la perméabilité entre le temps professionnel et le temps personnel n’a jamais été aussi grande. Le télétravailleur doit donc trouver les moyens de gérer son autonomie et les contraintes qu’implique un tel bouleversement des méthodes de travail. Le salarié qui ne peut suivre des règles d’organisation précises, soit de son fait soit de celui de l’entreprise, risque de voir son travail envahir progressivement son temps de loisir ou de repos. Cet aspect ressort de l’enquête demandée par le Forum (cf. partie B).
III.- UN ENVIRONNEMENT DE CONFIANCE POUR DEVELOPPER LE TELETRAVAIL
|
|
La croissance des technologies de l’information et de la communication permet un développement du télétravail qui modifie en profondeur l’organisation même du travail. Le télétravail offre des opportunités importantes pour les entreprises et constitue également une attente pour un certain nombre de salariés désireux de modifier leur façon de travailler.
Pour autant, le développement du télétravail paraît entravé par un certain nombre d’interrogations. Les auditions menées par le Forum des droits sur l’internet ont montré que celles-ci émanaient tant des salariés que de leurs employeurs et qu’elles sont principalement liées au développement du télétravail informel. Or, si l’on souhaite que les potentialités du télétravail soient exploitées par toutes les parties, il est nécessaire de mettre en place un environnement de confiance entre l’employeur et le salarié, répondant aux questions posées. De cette manière, le télétravail sera un pari gagnant pour tous.
Le Forum estime que cet environnement de confiance, permettant un développement harmonieux du télétravail, doit être organisé autour des cinq principes suivants :
1. Le télétravailleur salarié est un salarié à part entière ; il n’est pas nécessaire d’élaborer un régime juridique particulier du télétravailleur. Le droit commun du salariat s’applique.
2. Cependant, le télétravail doit intervenir dans un cadre juridique adapté et sécurisé. Pour cela, la situation de télétravail doit être expressément formalisée dans le contrat de travail ou son avenant. En outre, compte tenu des spécificités du travail à distance, des modalités particulières doivent être prévues, dans le contrat de travail, dans un accord collectif, par la loi ou encore au titre des bonnes pratiques.
3. Le télétravail ne doit pas isoler le télétravailleur de son collectif de travail : il convient d’organiser la relation du télétravailleur avec son environnement de travail et avec les institutions représentatives du personnel.
4. Le télétravail doit procéder d’une démarche volontaire de la part du salarié et adaptée aux besoins de l’employeur.
5. L’état de télétravail ne doit pas porter atteinte à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle et nécessite une réflexion sur la charge de travail.
A.- Le télétravailleur salarié est un salarié à part entière
Le télétravail constitue certes une organisation différente du travail mais il ne doit pas modifier pas le rapport qui existe entre le télétravailleur et l’entreprise qui l’emploie.
Si le télétravail favorise l’autonomie du télétravailleur, il ne doit pas remettre pas en cause le lien juridique de subordination qui existe entre le télétravailleur et l’entreprise qui l’emploie, frontière entre le travail salarié et le travail indépendant.
Il a pu être avancé que les dispositions contenues au sein des articles L. 721-1 et suivants du Code du travail concernant les » Travailleurs à domicile » s’appliquaient clairement au télétravail. Outre le fait que ces articles, dont certains datent du début du siècle dernier, sont en partie inapplicables au travailleur salarié (les points sur la déclaration d’embauche, les heures supplémentaires…) et qu’ils ne tiennent pas compte de la diversité des télétravailleurs (nomades etc.), le statut de travailleur à domicile n’est pas nécessairement plus favorable que le droit commun.
Même si le droit commun a vocation à s’appliquer pour le télétravail, la mise en place d’un cadre renouvelé de confiance entre l’employeur et le salarié répondant aux interrogations soulevées passe par des règles et des pratiques adaptées au télétravail. C’est pourquoi, il convient d’adapter le droit commun en prévoyant, selon leur nature, des modalités propres à cette forme de travail que ce soit dans le contrat de travail, dans un accord collectif ou dans la loi.
| Le Forum considère que les dispositions du code du travail concernant les » Travailleurs à domicile » ne sont pas adaptées au domaine du télétravail.Le droit commun a donc vocation à s’appliquer pour le télétravail salarié.Dès lors, il ne paraît pas justifié de prévoir un régime particulier du télétravailleur qui se distinguerait du régime juridique du salariat.Cependant, eu égard à la spécificité du télétravail, le droit commun doit, le cas échéant, être adapté. Des modalités propres à cette forme de travail doivent être prévues, selon leur nature, dans le contrat de travail, dans un accord collectif, par la loi ou au titre des bonnes pratiques. |
B.- Le télétravail doit s’accompagner d’un cadre juridique adapté et sécurisé
1.- Formaliser et rendre transparentes les conditions du télétravail
Il a été rappelé que l’un des principaux risques entourant le télétravail est un développement informel non maîtrisé de cette nouvelle relation de travail. L’exercice à distance de l’activité professionnelle implique donc de formaliser la mise en télétravail par un contrat de travail ou son avenant. Cette formalisation est nécessaire et elle permettra la mise en œuvre du télétravail de façon claire et transparente.
| Le Forum recommande que la mise en télétravail soit formalisée par un contrat de travail ou un avenant à celui-ci. Le Forum souhaite que cette disposition fasse l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation collective au niveau interprofessionnel. |
Le contrat de travail devra notamment porter sur les points suivants :
1. Le principe d’une période d’adaptation au télétravail pendant laquelle le salarié ou l’employeur peuvent décider de mettre fin au télétravail (cf. D 2. » télétravail, période d’adaptation et réversibilité« ).
2. Le descriptif du poste, du temps et de la charge de travail correspondante (cf. E 1. » La mesure de la charge de travail « ).
3. Les plages horaires d’accessibilité du télétravailleur (cf. E 2. » Amplitude de la journée de travail et droit au repos « ).
4. Le ou les lieux de travail et la rémunération (cf. A 4. » Le local du télétravailleur « ).
5. Les règles d’utilisation du système informatique et du traitement des données (cf. A 5. a. et b. » Clarifier l’utilisation de l’équipement par le télétravailleur et son contrôle par l’employeur « ).
6. La prise en charge des coûts d’installation, de maintenance et d’équipements ainsi que des coûts induits (cf. A 5. a. » Clarifier l’utilisation de l’équipement par le télétravailleur et son contrôle par l’employeur « ).
De plus, et toujours afin de rendre transparente toute mise en télétravail, il conviendrait aussi de faire apparaître clairement sur le registre unique du personnel les salariés qui sont en télétravail. Cette transparence permettrait également d’éviter, le cas échéant, les évolutions non souhaitées vers le statut d’indépendant.
Le Forum estime en effet qu’il convient de veiller à ce que le développement du télétravail ne conduise pas les entreprises à faire sortir, contre leur gré, les télétravailleurs du statut de salarié. Le télétravailleur doit donc demeurer dans un lien salarial et sa mise en télétravail ne doit pas être l’occasion de voir se transformer à son insu son statut en celui d’indépendant.
| Le Forum recommande que l’état de télétravail soit mentionné dans le registre unique du personnel. Une telle disposition ferait l’objet d’une réglementation particulière. A cet effet il conviendrait de compléter l’article R. 620-3 du code du travail en y faisant expressément porter la mention » télétravailleur « . |
2.- Instaurer une présomption d’accident du travail au domicile
La présomption d’accident du travail est instituée par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale[24]. La Cour de Cassation a interprété cet article et étendue la règle de la présomption d’accident du travail pour les salariés en mission ou en déplacements. Alors qu’auparavant, elle distinguait, pendant la mission, les périodes où l’intéressé accomplissait un acte professionnel et les périodes où il accomplissait un acte de la vie courante, considérées comme des interruptions de sa mission, depuis plusieurs arrêts rendus le 19 juillet 2001[25] cette distinction est abandonnée. Le principe est que l’accident survenu en cours de mission est un accident du travail. L’employeur, s’il le conteste, doit apporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif d’intérêt personnel ou que la lésion a une cause étrangère au travail.
Le travail nomade semble ainsi entrer dans le cadre du régime des accidents de mission. Si un accident survient alors que le salarié se déplace pour des raisons professionnelles, il doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge.
En revanche, la question est plus délicate pour le télétravail au domicile. L’interprétation de la Cour de Cassation sur la présomption d’accident du travail est en effet assez restrictive car pour en bénéficier, le salarié doit être sous le contrôle de l’employeur. Or, l’employeur ne peut en principe exercer son pouvoir de direction au domicile du salarié. Il s’ensuit que le salarié qui déclare un accident du travail au domicile devra faire la preuve que l’accident est imputable à l’activité professionnelle.
| Le Forum propose que soit prévue une présomption d’accident du travail lorsque la situation de télétravail a été formalisée par le contrat de travail ou par son avenant et que l’accident survient au domicile dans le cadre de la réalisation de ses missions. Ce principe ne pourrait, en revanche, être étendu aux télétravailleurs informels dont la situation n’a pas fait l’objet d’un avenant au contrat de travail. En effet, dans ce cas, il serait impossible de vérifier si l’accident est survenu à l’occasion du travail effectué. |
3.- Assurer la santé et la sécurité du télétravailleur
En pratique les accidents liés à l’utilisation des technologies de l’information semblent assez rares. Les chiffres évoqués par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) indiquent notamment un taux de sinistre très bas pour le travail à domicile[26]. Pour autant, la santé et la sécurité du télétravailleur doivent être garanties.
Cette exigence de prévention n’est pas difficile à faire respecter lorsque le télétravail s’effectue dans les locaux de l’entreprise ou bien en télécentres. Elle se pose en revanche de manière plus spécifique pour le télétravail à domicile.
En effet, la responsabilité en matière de prévention, de préservation de la santé et de la sécurité du télétravailleur incombe dans tous les cas à l’employeur, conformément aux principes généraux du droit du travail.
Dans le cadre du télétravail à domicile, sa responsabilité pénale serait engagée en cas d’incident de nature professionnelle survenu sur le poste de travail du salarié. En revanche, l’employeur ne serait pas responsable de la sécurité de l’ensemble du domicile du salarié. En effet, la vie privée du télétravailleur devant être respectée, les prérogatives de l’employeur seront limitées à l’espace et aux installations dédiés au travail.
Les télétravailleurs à domicile doivent bénéficier des mesures de protection identiques à celles appliquées aux salariés de l’entreprise ou de l’établissement.
Il convient de rappeler que l’employeur doit assurer une information sur l’ergonomie du poste de travail, sur l’hygiène, la sécurité et les risques inhérents aux situations de travail rencontrées. Il appartient ensuite au salarié de respecter les prescriptions portées à sa connaissance, notamment en matière de travail sur écran. Le matériel fourni au télétravailleur doit être de la même qualité que le matériel des salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise.
La surveillance médicale des télétravailleurs est assurée par le médecin du travail de l’entreprise ou du service de santé au travail inter-entreprise auquel elle adhère.
Un point particulier sur le travail sur écran doit être mentionné. En effet, et même s’il a été reconnu que le travail sur écran ne nuit pas à la santé des télétravailleurs, un travail intensif sur un poste mal adapté peut engendrer des effets sur la santé tels que notamment, fatigue visuelle, troubles musculo-squelettiques etc.
| C’est pourquoi, le Forum souhaite que le télétravailleur qui est affecté pendant une partie importante de son temps de travail sur équipements comportant des écrans de visualisation puisse bénéficier d’une visite médicale avant son affectation à ces travaux ainsi que le prévoit le décret n° 91-451 du 14 mai 1991[27]. Les modalités établissant cette surveillance médicale pourraient faire l’objet d’une clause particulière dans les conventions ou accords établis.Le Forum propose également que le salarié puisse bénéficier, avec son accord, d’une visite de l’inspection du travail, du médecin du travail, du CHSCT et d’un délégué du personnel mais aussi d’un intervenant en prévention des risques professionnels dans le cadre de la démarche d’évaluation des risques au travail. |
En revanche, les visites à l’initiative de l’employeur doivent respecter le principe de l’inviolabilité du domicile. L’accord-cadre prévoit que le salarié doit pouvoir refuser l’accès à son domicile et exige une notification préalable de la visite sur le lieu de travail du salarié (art 8. » Santé et sécurité « ).
Le caractère spécifique de la situation de télétravailleur peut occasionner tout autant un sentiment de bien-être au travail que l’émergence de problèmes de santé au travail jusque là mal connus ou non pris en compte en particulier sur les effets à terme qui peuvent être très divers selon les modalités d’organisation mises en place.
4.- Le local du télétravailleur
L’idée de poser comme condition légale du télétravail à domicile de bénéficier d’un local exclusivement réservé semble, en théorie, intéressante car de nature à bien cloisonner l’espace de la vie professionnelle de celui de la vie privée. En pratique, disposer d’une pièce spécifique au domicile semble difficile pour beaucoup de salariés dans les grandes villes en raison de l’exiguïté des logements et du prix que coûterait l’espace ainsi dédié au télétravailleur à domicile.
| Le Forum constate qu’il paraît impossible de prévoir par principe l’octroi d’un local dédié au télétravail. En revanche, le Forum recommande que le télétravail s’exécute dans une zone spécifique du logement.Le Forum souhaite que le télétravailleur puisse se faire assister, notamment sur le plan des règles d’ergonomie, pour l’installation de son bureau. |
5.- Clarifier l’utilisation de l’équipement par le télétravailleur et son contrôle par l’employeur
a.- Clarifier l’utilisation de l’équipement et la prise en charge des coûts
L’accord-cadre européen prévoit qu’en principe l’employeur est chargé de fournir, d’installer et d’entretenir les équipements nécessaires au télétravail régulier, sauf si le télétravailleur utilise son propre équipement en accord avec son employeur.
Il peut s’avérer utile de déterminer clairement l’utilisation qui doit être faite de l’équipement mis à disposition.
| Le Forum recommande que l’entreprise fournisse l’équipement du télétravailleur ; en principe, cet équipement doit être dédié à un usage professionnel. |
Tel pourrait être le cas de l’équipement informatique, d’un téléphone avec une ligne professionnelle ou de tout autre équipement nécessaire à la réalisation des tâches professionnelles du télétravailleur. Cet équipement ne devrait être utilisé que pour l’activité professionnelle du télétravailleur.
Comme l’avait indiqué le Forum des droits sur l’internet dans sa recommandation du 17 septembre 2002, Relations du travail et internet, une interdiction d’utilisation du matériel professionnel à des fins personnelles ne parait pas illégale. Le Forum rappelle cependant que les règles d’utilisation du matériel à des fins personnelles doivent être mentionnées dans le contrat de travail, le règlement intérieur ou dans une charte de l’entreprise.
Par ailleurs se pose la question de la responsabilité de l’équipement fourni. La mise à disposition de ce matériel peut nécessiter une révision du contrat d’assurance multirisques habitation du télétravailleur, le surcoût pesant en principe sur l’employeur.
| Pour éviter les litiges liés à l’installation, la maintenance et l’utilisation de l’équipement, le Forum recommande de prévoir dès le départ les modalités et le cas échéant la répartition des frais afférents. La participation de l’employeur aux coûts du télétravail devra être clairement définie avant le début du télétravail et formalisée dans le contrat de travail.Le Forum recommande également que les règles d’utilisation du matériel professionnel à des fins personnelles soient clairement définies avant le début du télétravail et formalisées dans le contrat de travail. |
Outre ces problèmes liés à la répartition des coûts d’équipements, la prise en charge d’autres coûts induits doit également être abordée :
– La prise en charge des coûts de déplacements ;
– La possibilité de bénéficier des tickets restaurant ou autres avantages existants
déjà négociés au sein de l’entreprise.
b.- Le contrôle par l’employeur et le respect de la vie privée
D’une manière générale, et ainsi que la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés l’a rappelé dans son rapport sur » la cybersurveillance sur les lieux de travail « [28], l’employeur doit respecter des principes fondamentaux posés par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 ainsi que par la loi du 31 décembre 1992 relative à la protection des libertés dans l’entreprise.
Parmi ces principes, il est important de rappeler qu’une information préalable doit être donnée au salarié ainsi qu’aux instances représentatives du personnel[29] si des outils de surveillance sont utilisés. De même, la mise en place de dispositifs de contrôle de l’activité du télétravailleur doit être strictement nécessaire et l’atteinte réalisée aux libertés du salarié proportionnée au but recherché[30]; ces règles s’inscrivent également dans le cadre de l’article L.120-2 du code du travail[31]. A cet effet, le Forum insiste sur le fait que l’utilisation de certains outils permettant des techniques de surveillance intrusives doit être particulièrement encadrée. Il s’agit par exemple de l’utilisation des web-cams pour surveiller le salarié ou encore de la géolocalisation des travailleurs nomades permettant de contrôler le parcours suivi par le salarié.
| D’une manière générale, le Forum rappelle que la loi impose d’informer le salarié ainsi que les représentants du personnel, des mesures prises pour contrôler l’activité, et notamment de les informer sur la collecte des données et leur utilisation par l’employeur. |
6.- Fiscalité, charges sociales et télétravail
L’impact de la mise en place du télétravail devrait être précisé au niveau de la fiscalité de l’entreprise.
A cet égard, il convient de rappeler que le traitement des cotisations sociales lié à la prise en charge des frais occasionnés par une mise en télétravail a été partiellement clarifié par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Cet arrêté prévoit que » Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l’employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé[32] « . Il prévoit également que » Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l’utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication qu’il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l’employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé « [33].
En ce qui concerne le traitement fiscal de la prise en charge de ces frais professionnels, le point est moins clair.
L’article 4 de la loi de finances pour 2001 a institué un régime fiscal et social particulier afin de favoriser le don de matériels informatiques par les entreprises à leurs salariés. Jusqu’à présent, les dons ou la fourniture à un prix inférieur au coût réel de matériels informatiques neufs et de logiciels aux salariés étaient considérés comme des avantages en nature. Ils étaient donc, en principe, soumis à l’impôt et aux cotisations sociales. Depuis le 1er janvier 2001, ces avantages en nature sont exonérés d’impôt sur le revenu, de cotisations, de CSG et de CRDS dans la limite de 1.525 € par salarié[34]. Mais la contrepartie de ce régime est la nécessité de réintégrer ces charges dans le résultat imposable de l’entreprise[35].
Le Forum des droits sur l’internet propose, sur le modèle de ce qui a été réalisé pour les cotisations sociales, que ces frais de mise en télétravail soient clairement désignés dans le code général des impôts comme des charges de l’entreprise déductibles de l’impôt sur les sociétés dès lors que ces frais sont prévus dans le contrat de travail et n’apparaissent pas manifestement excessifs. Les sommes versées au salarié ne seraient pas imposables à l’impôt sur le revenu. Une instruction de la direction générale des impôts pourrait fixer cette règle dans un souci de sécurité juridique des entreprises et des télétravailleurs.Le Forum propose également que les entreprises employant des télétravailleurs à domicile profitent d’une diminution de la taxe versement transport et d’un système dégressif de taux de cotisation accidents du travail.Une diminution de la taxe versement transport permettrait de tenir compte du fait que le taux d’engorgement des infrastructures de transport devrait être plus faible.
Une diminution des cotisations accidents du travail par le biais d’un système dégressif du taux de cotisation permettrait de tenir compte du fait que le taux de sinistre d’accidents devrait être plus faible pour ces entreprises qui présentent moins de risques d’accidents de travail et d’accidents de trajet. Il serait donc logique que cette moindre sinistralité soit prise en compte. |
C.- Le télétravail ne doit pas isoler le télétravailleur de son collectif de travail
1.- La prise en compte de l’incidence du télétravail sur l’organisation du travail
Il a été noté plus haut que la mise en télétravail était freinée non pas pour des raisons techniques mais essentiellement à cause du changement d’ordre culturel et managérial que cela implique.
Or, une des clés du succès du télétravail est une bonne insertion du télétravailleur dans son équipe.
A cet égard, le manager joue un rôle essentiel dans la recherche de ce fonctionnement harmonieux. Il doit apprendre à diriger son équipe sans pouvoir contrôler de visu le travail de son collaborateur. Pour ce faire, il est souhaitable qu’il pratique un management par objectifs, qu’il adapte son mode de communication avec ses subordonnés et que le système de mesure des résultats soit clair et compris de tous. L’introduction du télétravail dans une organisation peut ainsi être une opportunité pour clarifier les méthodes de management.
Au-delà, l’introduction du télétravail n’est pas neutre en terme d’organisation collective de travail. Il doit donc faire l’objet d’une réflexion collective au sein de l’entreprise, notamment avec les partenaires sociaux.
| A cet égard, le Forum recommande que toute mise en place d’un projet de télétravail soit considérée comme un » projet important » au sens de l’article L.432-2 du code du travail[36] et que, dès lors, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel soient consultés. A cette fin, le Forum recommande que ledit article soit complété pour qu’il y soit clairement fait mention du terme » télétravail « .Afin que la population des télétravailleurs soit mieux connue, le Forum recommande également que le télétravail fasse l’objet d’un item particulier (nombre et caractéristiques des télétravailleurs) au bilan social ou au bilan de responsabilité sociale de l’entreprise. |
2.- Organiser la relation du télétravailleur avec son collectif de travail et avec les institutions représentatives du personnel
La mise en place du télétravail doit s’accompagner d’une réflexion sur les mesures à prendre pour prévenir l’isolement du télétravailleur par rapport aux autres travailleurs de l’entreprise. Cette préoccupation est essentielle pour éviter la marginalisation du télétravailleur et le dysfonctionnement de son équipe. Le télétravailleur doit avoir la possibilité de rencontrer régulièrement ses collègues, de participer aux réunions de service et de projet ou encore d’accéder aux informations de l’entreprise.
Même s’il est impossible de fixer a priori des règles relatives à l’organisation du travail dans l’entreprise, on constate néanmoins que de nombreuses entreprises conservent le principe d’une présence physique régulière au sein des locaux. La plupart des entreprises auditionnées par le Forum des droits sur l’internet ont d’ailleurs choisi de développer le télétravail alterné organisé autour d’un nombre fixe de journées au sein de l’entreprise (de une à trois journées dans la plupart des cas). En tout état de cause, ne peuvent être mis en situation de télétravail que des salariés déjà bien insérés dans le collectif de travail sauf dans le cas de situation initiale bien spécifique.
L’insertion du télétravailleur dans son collectif de travail pose également la question de leur accès aux organisations syndicales et aux représentants du personnel. Le télétravailleur distant de l’entreprise ne dispose pas facilement des informations syndicales traditionnelles portées sur les panneaux d’affichage et les tracts. Il peut également avoir des difficultés à communiquer avec les représentants du personnel et à être présent à des réunions d’information.
| Le Forum recommande que soient élaborés des accords d’entreprise portant sur l’utilisation par les représentants du personnel des moyens de communication électronique de l’entreprise (intranets et messagerie électronique) avec les télétravailleurs. A cet égard, on rappellera que l’article 52 de la loi sur le dialogue social a complété l’article L.412-8 du code du travail, pour prévoir la possibilité de conclure de tels accords d’entreprise sur l’utilisation des intranets et des messageries d’entreprise par les organisations syndicales.Le Forum recommande que les représentants du personnel disposent, pour les télétravailleurs qui n’y sont pas opposés, des informations sur ceux-ci nécessaires au bon exercice de leur fonction (adresse, courriel…).Le Forum recommande que, dans le cadre de leur possibilité de rencontrer les salariés, les délégués du personnel puissent rencontrer les télétravailleurs qui le souhaitent sur leur lieu d’exercice (centres délocalisés ou domicile). Pour ce faire, il conviendrait que les partenaires sociaux portent leurs réflexions sur la possibilité de prévoir pour les délégués du personnel des moyens spécifiques (crédit d’heures, frais de déplacements, connaissance effective des heures de présence des télétravailleurs dans les locaux de l’entreprise…) leur permettant de favoriser les contacts avec les télétravailleurs. Ces moyens dépendraient du nombre de télétravailleurs dans l’entreprise. |
D.- Le télétravail doit procéder d’une démarche volontaire et adaptée
Tous les postes de travail ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une organisation en télétravail. En effet, la nature de certaines tâches empêche d’envisager un travail à distance des locaux de l’entreprise.
Au-delà de ces limites évidentes, tous les salariés ne peuvent pas télétravailler. En effet, cette forme d’organisation du travail suppose une grande autonomie et une capacité d’organisation et de rigueur du travail auquel s’ajoute le sens des responsabilités.
En outre, certains salariés dotés de ces qualités ne souhaitent pas télétravailler.
C’est pourquoi le télétravail doit reposer sur une action volontaire de l’employeur et du télétravailleur[37]. Ainsi, quand le travail au domicile n’est pas initialement prévu dans le contrat de travail, l’employeur ne peut imposer unilatéralement un tel bouleversement dans les conditions de vie du salarié. On notera, à cet égard, que la jurisprudence Abram la Cour de cassation a confirmé le caractère volontaire du travail au domicile en rappelant que le salarié « n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail« [38].
La situation est moins claire pour le travail nomade et le travail dans des locaux distants. La jurisprudence considère en effet que la mention du lieu de travail dans le contrat a seulement valeur informative sauf clause expresse. Pour autant, d’un point de vue managérial, il serait illusoire de penser que la mise en place du télétravail peut se faire contre la volonté d’un salarié.
1.- Une attention particulière pour l’embauche directe d’un nouveau salarié en télétravail
L’accord-cadre européen prévoit que le télétravail peut faire partie du descriptif initial du poste du travailleur[39].
Certains semblent penser qu’une première embauche devrait concerner uniquement un travail réalisé dans les locaux de l’entreprise, quitte par la suite à modifier le contrat de travail pour permettre le télétravail. Il s’agirait d’éviter une déstructuration du collectif de travail et l’embauche de salariés isolés ignorant tout du fonctionnement concret de l’entreprise, tant dans l’intérêt de celle-ci que dans celle du salarié. Mais certaines des auditions ont montré que des entreprises se mettent directement en place autour du télétravail.
Il est également important que le salarié soit pleinement informé des conditions dans lesquelles il pourrait être appelé à exercer son activité sous la forme du télétravail.
| Il paraît difficile d’éviter toute embauche directe en télétravail, dès lors que les conditions de recrutement sont claires. Le Forum estime néanmoins important que le nouveau salarié, embauché directement en télétravail, connaisse la culture de l’entreprise, ses collègues de travail etc. Pour ce faire, les entreprises pourraient, au titre des bonnes pratiques, prévoir une période où, avant de passer en télétravail, le nouveau salarié assurerait une partie de son activité au sein des locaux de l’entreprise. |
2.- Télétravail, période d’adaptation et réversibilité
Lorsque le télétravail ne fait pas partie du descriptif initial du poste, l’accord-cadre européen prévoit que la décision de passer au télétravail est possible et réversible par accord individuel et/ou collectif[40].
Le télétravailleur et l’employeur peuvent ainsi s’interroger sur la possibilité de demander le retour du télétravailleur dans les locaux de l’employeur si l’expérience n’est pas concluante ou si la situation du télétravailleur se modifie. L’employeur, lui-même, peut vouloir renoncer à cette mise en télétravail.
Dès lors, il est nécessaire de prévoir une possibilité de mettre fin, à la demande du télétravailleur ou de l’employeur, rapidement à l’expérience lorsque celle-ci s’avère non concluante.
| Le Forum recommande de prévoir une période d’adaptation ou de découverte au télétravail dans le contrat de travail ou son avenant. Durant cette période, le salarié ou l’employeur peuvent décider unilatéralement de mettre fin au télétravail.Sur le long terme, le Forum recommande que la possibilité pour l’employeur et le salarié de mettre fin à une activité exercée en télétravail soit prévue, selon des modalités établies par accord individuel ou collectif. |
3.- La formation au télétravail
Il paraît nécessaire de prévoir une formation spécifique au télétravail pour les télétravailleurs et leur hiérarchie directe ainsi qu’une information spécifique pour les collègues de travail. Ce point vient en plus du fait que le télétravailleur doit pouvoir bénéficier d’une formation professionnelle identique à celles de ses collègues pour son évolution et pour les compétences de l’entreprise.
| A cet égard, le Forum recommande que :Les télétravailleurs soient informés par voie électronique des possibilités de formation professionnelle qui leur sont ouvertes, soit sur l’intranet de l’entreprise, soit par le biais de la messagerie électronique.L’accès des télétravailleurs à la formation professionnelle puisse faire l’objet d’une information au bilan social et devrait être mentionné dans le bilan de responsabilité sociale de l’entreprise.La formation des télétravailleurs soit facilitée et renforcée par le développement de la formation à distance par internet et à cet effet intégrée dans des programmes de » e-learning « .Un » quota » de formation au télétravail puisse être intégré dans le 1% formation pour les entreprises qui pratiquent ce mode d’organisation. Ce quota pourrait constituer une rubrique de l’accord d’entreprise sur le télétravail.
Le PCIE (passeport de compétences informatique européen) puisse être adopté comme outil d’évaluation des compétences informatiques du télétravailleur pour déterminer la nature de ses besoins en formation dans le domaine informatique.
Les managers reçoivent une formation spécifique au développement du télétravail de leurs collaborateurs et au management à distance. |
E.- Mesure de la charge de travail et droit au repos
1.- La mesure de la charge de travail
Il s’agit de l’écueil principal du télétravail. En ce sens, le télétravail traduit la difficulté, dans un nombre croissant de secteurs, de bien cerner la charge de travail. En effet, avec cette nouvelle forme d’organisation du travail, le temps de travail n’est plus l’indicateur référent pour mesurer la contribution du salarié. La charge de travail semble alors permettre une meilleure estimation du travail effectué. Travailler en fixant des objectifs à atteindre, tout en laissant au salarié une grande liberté d’organisation, sont des modalités qui semblent correspondre davantage à la réalité d’un nombre grandissant de tâches dont la plupart peuvent être exercées en télétravail. A cet égard, la création de la catégorie des cadres autonomes[41] et du forfait-jour par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont révélatrices de cette évolution.
Il paraît possible d’établir une typologie des modalités de contrôle de la charge de travail.
Certaines activités semblent pouvoir être contrôlées à partir d’une norme de production, selon le principe visant à déterminer les temps moyens d’exécution institués pour le travail à domicile traditionnel. Ainsi, on peut quantifier la charge de travail de salariés réalisant la saisie d’informations administratives (établissement d’actes, comptabilité…) à partir du temps moyen de traitement et des tâches annexes. Le temps de travail prescrit résulte alors du produit du nombre d’actes par le temps moyen d’un acte. Il ne peut conduire à un dépassement des durées de travail autorisées. Il convient de rappeler que la quantification de ces normes doit se traduire par un accord collectif.
| Le Forum recommande que, lorsque la charge de travail peut être déterminée à partir de temps moyens d’exécution, ces temps ainsi que les salaires correspondants soient fixés par accords collectifs de branche ou, à défaut, par accords d’entreprise. Les salaires ainsi fixés doivent assurer une rémunération équivalente à celle versée aux salariés de qualification similaire réalisant des tâches comparables dans les locaux de l’entreprise. |
D’autres activités pourraient se prêter à un contrôle de la charge de travail à partir d’un temps mesurable techniquement (temps de connexion au serveur de l’entreprise…). Une personne chargée de donner des informations en temps réel peut voir sa charge de travail évaluée à partir de son temps de connexion au réseau de l’entreprise.
| Afin que le contrôle effectué sur la charge de travail soit mené de façon transparente, le Forum recommande que l’employeur et le salarié aient la même accessibilité aux indicateurs de temps de connexion et autres temps d’activité professionnelle mesurables par logiciels (nature, délais, modes de conservation). |
Enfin, pour d’autres d’activités, le télétravail se prête assez naturellement à une mesure de travail par fixation d’objectifs. Dans ce cas, l’employeur fixe des objectifs en accord avec le salarié et ce dernier sera tenu de les respecter. Cependant, la jurisprudence a fixé un certain nombre de principes. Selon la Cour de Cassation, il faut que la charge induite par la fixation d’objectifs puisse être assurée pendant la durée légale du travail. Ainsi, si elle admet que l’employeur est en droit de définir unilatéralement le contenu des objectifs, encore faut-il que ces derniers soient réalistes[42]. Ces objectifs doivent également être adaptés aux horaires de travail du salarié et ne doivent pas le pousser à dépasser les durées maximales du travail, ni empiéter sur le temps de repos.
| Le Forum considère que l’estimation de la charge de travail doit faire l’objet, au niveau de ses principes, d’une négociation entre partenaires sociaux au sein de l’entreprise et d’une discussion au sein du CHSCT. Au titre des bonnes pratiques, l’estimation de la charge de travail devrait également faire l’objet d’une discussion entre le télétravailleur et son employeur à l’occasion de la définition de ses objectifs. |
Il reste enfin la possibilité d’utiliser un système du type du forfait-jour pour l’ensemble des télétravailleurs. Les auditions menées par le Forum ont montré que cette éventualité fait débat. A cet effet, il convient de bien distinguer le droit commun du temps de travail des régimes particuliers qui s’appliquent aux cadres et aux itinérants non cadres.
Le cadre au forfait-jour se trouve soumis à un régime assez particulier puisqu’il dispose d’une quasi totale liberté d’organiser son temps de travail sous réserve de respecter les temps de repos (repos quotidien de 11 heures consécutives[43], repos hebdomadaire) et que cette organisation ne conduise pas à dépasser 218 jours de travail par an. La souplesse qu’offre les conventions individuelles de forfait semble ainsi correspondre aux conditions particulières de travail des télétravailleurs cadres.
Le salarié itinérant non cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps[44] peut être soumis au régime particulier du forfait en heures sur l’année, lorsqu’un accord collectif le prévoit. Cet accord peut même déroger aux règles relatives à la durée journalière de travail de dix heures et à la durée hebdomadaire mais doit respecter le repos quotidien de 11 heures, le repos hebdomadaire et les cinq semaines de congés.
Hormis ces régimes précis, le droit commun a vocation à s’appliquer aux autres télétravailleurs (durée hebdomadaire de travail effectif de 35h00 majorée, le cas échéant, des heures supplémentaires, durée quotidienne du travail de 10 heures par jour maximum, sauf dérogation).
On peut ainsi estimer que les dispositions du droit commun semblent peu adaptées au télétravail et que les régimes des salariés cadres (forfait-jour) et des non cadres itinérant (forfait-heure annuel) s’adaptent aisément à la situation de télétravail en raison de la grande souplesse dans la gestion du temps de travail qu’ils autorisent.
Pour autant, le Forum considère qu’il n’est pas opportun d’envisager d’étendre le champ d’application du système du forfait-jour à l’ensemble des salariés non cadres au motif qu’ils sont en télétravail, en raison des dérogations importantes que ce régime juridique introduirait en matière de durée de travail.
En revanche, le Forum considère que les télétravailleurs non cadres qui disposent d’une réelle autonomie pourraient bénéficier du régime du forfait en heures sur l’année déjà applicable pour les salariés itinérants non cadres.
| D’une manière générale, le Forum recommande que les partenaires sociaux, dans le cadre des négociations relatives à la mise en place des conventions de forfait, précisent les modalités d’application des textes existants aux télétravailleurs non cadres qui disposent d’une réelle autonomie. |
2.- Amplitude de la journée de travail et droit au repos
Au-delà de la charge de travail, la question de l’amplitude de la journée de travail se pose. Comme cela a été constaté (cf. I. B 2.5 » Les télétravailleurs bénéficient d’horaires plus souples mais aussi plus longs « ), le télétravail s’accompagne souvent de débordements du travail sur le temps personnel ou familial.
Ce constat d’une interpénétration entre vie professionnelle et vie personnelle a conduit bon nombre d’observateurs à évoquer la mise en place d’un véritable droit à la déconnexion. A cet égard, il convient de noter que le cadre légal ne mentionne pas de droit à la déconnexion mais institue un droit au repos.
L’employeur doit ainsi prendre en compte les dispositions applicables au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Ces dispositions garantissent au salarié un temps pendant lequel il peut librement vaquer à ses occupations personnelles. Le salarié peut donc s’appuyer sur ces garanties légales pour bénéficier d’un réel droit au repos permettant de sauvegarder le respect de sa sphère personnelle.
Pour autant, il faut conserver au télétravail, notamment à domicile, une souplesse d’organisation pour le salarié. Le salarié en situation de télétravail sort très souvent des cadres horaires et journaliers fixés par la loi et réduit par la même son temps de repos. Cette intrusion dans la sphère du repos se faisant souvent de manière spontanée, de la part du salarié lui-même.
| Afin de prendre en compte les réalités liées à cette nouvelle façon de travailler mais surtout pour éviter toute dérive et prévenir les risques que pourraient courir tant l’employeur que le salarié, le Forum des droits sur l’internet estime qu’une discussion doit s’amorcer au sein des entreprises entre les représentants du personnel et l’employeur afin d’assurer l’application effective de ce droit au repos en fonction de l’amplitude de travail.Le Forum rappelle que la période de travail effectif du télétravailleur doit respecter le temps de repos de onze heures consécutives par jour et ne doit pas excéder l’amplitude maximale de travail journalière. Le Forum recommande, qu’au sein de cette période, le contrat de travail précise les plages horaires d’accessibilité où le télétravailleur doit pouvoir être joint. |
F.- Les pouvoirs publics doivent accompagner le développement du télétravail
Comme cela a été rappelé, aucune étude n’a été menée sur l’impact du télétravail sur les entreprises et les salariés et sur la mesure statistique de cette nouvelle modalité de travail. Il convient néanmoins de noter qu’à compter de 2005, les enquêtes annuelles de la Dares sur les conditions de travail vont, pour la première fois, porter sur le thème du télétravail.
A l’instar de ce qui a été mené dans la plupart des pays de l’Union Européenne, les pouvoirs publics français devraient accompagner le développement du télétravail en facilitant une meilleure connaissance en France du phénomène et en mobilisant divers mécanismes incitatifs ou de sensibilisation.
| Le Forum recommande que les pouvoirs publics lancent des études permettant de mieux connaître la réalité du télétravail en France. Ces études permettraient un recensement statistique exhaustif sur le télétravail en France afin de disposer d’indicateurs précis sur les effets réels du télétravail sur les conditions de travail et de vie. |
Le Forum des droits sur l’internet se propose d’accompagner ces actions en élaborant un guide pratique sur le télétravail à destination des entreprises et des salariés qui indiquerait les principes à suivre pour la mise en télétravail. Ce guide pourrait être diffusé sur tous les sites internet publics et dans les Espaces Publics Numériques.
| Le Forum se propose d’élaborer un guide pratique sur le télétravail à destination des entreprises et des salariés. Ce guide servirait de mode d’emploi pour la mise en télétravail(informations juridiques, ergonomiques, fiscales etc.). |
En quelques années le développement puis la généralisation de l’outil informatique a induit de nouvelles façons de travailler ; le télétravail en est l’une des plus marquantes.
Pour autant, cette nouvelle forme d’organisation du travail peut-elle se développer dans notre pays ? La question mérite d’être posée. Les données les plus récentes estiment en effet que 2% de la population salariée télétravaillent à domicile et que 5% télétravaillent de façon nomade. Le nombre d’abonnés au haut débit est en progression forte et constante (de 500.000 en 2002 on passe à 6 millions d’abonnés en 2004) et 65% des internautes à domicile sont aujourd’hui connectés à un accès haut débit alors qu’ils n’étaient que 30% en 2003.
A cette augmentation de l’équipement des ménages s’ajoute un réel changement de mentalités dans le monde du travail. Les salariés, tout comme nombre de managers, revendiquent plus d’autonomie et de souplesse dans la gestion de leurs tâches et cherchent à mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée. Beaucoup voient dans l’outil informatique les moyens de répondre à ces aspirations complexes.
On assiste cependant à un paradoxe : alors que le télétravail séduit de plus en plus d’employeurs et de salariés, il suscite un grand nombre d’interrogations, voire d’appréhensions chez ces derniers.
En effet, cette forme d’organisation du travail peut être déstabilisante tant pour l’employeur que pour le salarié car elle modifie la notion de collectif dans une entreprise et introduit un certain flou dans la définition même du travail, celui-ci ne s’exerçant plus dans un lieu précis et dans des horaires clairement délimités. De plus, la mise en télétravail se fait essentiellement de façon informelle et spontanée, ce qui nécessite de repenser un certain nombre de questions, résolues pour le travail classique au sein de l’entreprise.
Dès lors, si l’on souhaite que l’ensemble des parties puisse bénéficier des potentialités du télétravail, il faut mettre en place un environnement de confiance entre salariés et employeurs, répondant aux questions posées et levant les appréhensions éventuelles. Le télétravail devient alors un pari gagnant pour tous.
Cet environnement de confiance passe par des règles ou des usages adaptés. Le présent rapport en a présenté les grandes lignes. Entreprises, pouvoirs publics, partenaires sociaux…, tous sont concernés et peuvent apporter leurs contributions à la mise en place d’un tel environnement. Cependant, à ce stade de la réflexion, celui-ci ne se présente pas comme un livre de recettes mais plutôt comme une sorte de » boite à outils « . Ces outils sont à la disposition des partenaires sociaux. Ces derniers vont en effet mener des négociations, dans le cadre de la transposition de l’accord-cadre européen du 16 juillet 2002, selon leur propre calendrier et modalités.
Un consensus semble se dégager sur la nécessité d’une négociation collective au niveau interprofessionnel reprenant les principes de l’accord-cadre. Cette voie permettrait de fixer des règles adaptées à la différence de situation des entreprises. Elle serait également un moyen d’expérimenter les solutions avant une éventuelle reprise législative des principes.
Ce processus permettrait de mettre en place, avec pragmatisme et concertation, un environnement de confiance pour le développement du télétravail en France et répondre ainsi aux besoins de sécurisation exprimés tant par les employeurs que les salariés.
Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer dans la mise en place de ce cadre : ce n’est pas un rôle moteur au sens de la politique industrielle des années passées, car le télétravail est d’abord un choix d’entreprise, mais plutôt un rôle d’accompagnement. Ils peuvent, à l’instar de ce qui été mené dans la plupart des pays de l’Union européenne, sensibiliser les entreprises et les salariés face à ces nouveaux usages, diligenter des études sur la mesure du phénomène, clarifier les quelques incertitudes juridiques existantes…, autant d’actions favorisant une appropriation naturelle et confiante dans cette nouvelle forme d’organisation du travail.
Un télétravail comme pari gagnant pour tous, voilà l’ambition de ce rapport.
ANNEXE 1
LETTRE DE MISSION
|
|
Consulter la lettre de mission
ANNEXE 2
COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL
|
|
La composition du groupe de travail était la suivante :
Jacques BABOT, responsable du secteur » e-travail » au sein de l’Unité » Nouveaux environnements de travail « , DG Société de l’information, Commission européenne
Denis BERARD, chargé de mission, Département « Innovation Technologique & Travail », Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail
Jean HILDBRAND, manager Projet Mobilité, IBM
Yves LASFARGUE, sociologue
Monique LARCHE-MOCHEL, médecin, chef de l’inspection médicale du travail et de la main-d’œuvre à la Direction des relations du travail et Odile SIRUGUET, médecin, adjoint au médecin chef de service de l’inspection médicale, Direction des relations du travail, ministère des affaires sociales
Jacques-François MARCHANDISE, directeur du développement, FING
Marie-France MAZARS, conseiller à la chambre sociale de la Cour de cassation
Liliane PIOT, Chef de projet, Département Equipement Numérique des Territoires, Caisse des dépôts et consignations
Christophe RADÉ, Professeur de droit du travail à l’Université Montesquieu (Bordeaux IV)
Jean-Marie ROUGER, chef de l’Agence Conseil du Travail en Réseau, EDF-GDF et Jean-Marie MARTHOS, Agence Conseil du Travail en Réseau, EDF-GDF
Nicole TURBÉ-SUETENS, consultante et experte européenne
Observateur de l’administration :
Jean-Claude MICHAUD, directeur adjoint du travail, Direction des relations du travail, ministère des affaires sociales
Rapporteurs du groupe :
Jean GONIÉ, chargé de mission au Forum des droits sur l’internet
Mathieu HERONDART, maître des requêtes au conseil d’Etat
Le groupe de travail a procédé aux auditions suivantes :Sylvie ANTOINE, directrice des ressources humaines de la Chambre des notaires de Paris
Jacques BABOT, responsable du secteur » e-travail » au sein de l’Unité » Nouveaux environnements de travail « , DG Société de l’information, Commission européenne
Hugues BAUDERE, président du Mouvement des Jeunes Notaires
Bruno de BEAUREGARD, co-président de Mayetic
Laurence BRETON-KUENY, chef du service ressources humaines, Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé
Paule CLAVEL, directrice de la direction informatique, Chef de projet télétravail, Rectorat de l’Académie de Bordeaux
Alain DUCASS, chef de mission » Aménagement numérique du territoire « , DATAR
Pierre DUPLATRE, directeur adjoint, responsable du département de l’assurance des risques professionnels, CNAMTS
Pascal EYMIN, directeur commercial du secteur industrie, CISCO
Andrée GERARD, sous-directeur, chargée de mission à la direction des risques professionnels, CNAMTS
Jean HILDBRAND, manager Projet Mobilité, IBM
Alain d’IRIBARNE, directeur de recherche, Laboratoire d’économie et de sociologie du travail, CNRS
Peter JOHNSTON chef d’Unité à la Direction Générale Société de l’information, responsable de l’unité Nouveaux environnements de travail, Commission européenne
Monique KAUFF, présidente de Génération CYBERHANDIWORK
Marie-France KOULOUMDJIAN, psychosociologue, Directeur de recherche à l’Ecole Centrale de Lyon, expert européen
Monique LARCHE-MOCHEL, médecin, chef de l’inspection médicale du travail et de la main-d’œuvre à la Direction des relations du travail
Anne LEFEVRE, directrice du télétravail, France Télécom
Patrick MAHOUE, chargé de mission sur le développement de l’emploi en télétravail de la communauté de Sillé-le-Guillaume
Marie-Claude MAILLARD, médecin inspecteur régional du travail, région Bretagne
Jacques-François MARCHANDISE, directeur du développement, FING
Fabienne MATIFAS, directrice des ressources humaines, CISCO
Marie-France MAZARS, conseiller à la chambre sociale de la Cour de cassation
Miguel MEMBRADO, co-président de Mayetic
Idir NAITAISSA, responsable du service des TIC à la Chambre des notaires de Paris.
Alain NINAUVE, directeur adjoint du travail, Département entreprises à la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Haute-Normandie
Michel QUILLET, président de la communauté de communes de Sillé-le-Guillaume
Christophe RADÉ, professeur de droit du travail à l’Université Montesquieu (Bordeaux IV)
Jean-Emmanuel RAY, professeur de droit du travail à l’Université de Paris I
Jean-Marie ROUGER, chef de l’Agence Conseil du Travail en Réseau, EDF-GDF
Patrick WATTEL, adjoint de direction, responsable de la formation, Association pour la réinsertion sociale et professionnelle des personnes handicapées de Troyes
Jeanine YIGIT-THOURON, directrice de la gestion du personnel, Accenture
Organisations professionnelles et syndicales auditionnées :
Jean-Pierre BERNARD, vice président du secteur des télécommunications, CFTC
Armand de BERNIERES, conseiller technique, UPA
Hubert BOUCHET, secrétaire général de l’Union des cadres et ingénieurs FO
Jean-Paul BOUCHET, secrétaire général adjoint, CFDT Cadres.
Pierre BURBAN, secrétaire général, UPA
Pierre CHARTRON, directeur du département analyse des emplois et organisation du personnel, UIMM
Soraya DJIDEL, responsable communication, CGPME
Samuel DOUETTE, chargé de mission, CJD
Fanny FAVOREL, juriste, CGPME
Chantal FOULON, directrice adjointe à la direction des Affaires sociales, MEDEF
Jean-Pierre KOECHLIN, président du secteur des télécommunications, responsable de la formation professionnelle et de l’emploi, CFTC
Alain LECANU, secrétaire national chargé du pôle emploi / formation, CGC
Alain MARCELLESI, secrétaire fédéral, Sud-PTT
Roland METZ, conseiller confédéral chargé des garanties collectives et des salaires, CGT
Nicolas MIJOULE, juriste, CGC
Dominique TELLIER, directeur à la direction des Affaires sociales, MEDEF
Djamel TESKOUK, conseiller confédéral chargé des questions de formation, CGT
Jack TORD, conseiller confédéral chargé de l’emploi, CGT
Alain TRIBOULT, CFTC
ANNEXE 4
QUELQUES REACTIONS ISSUES DE L’APPEL A TEMOIGNAGES
|
|
Afin d’accompagner la réflexion du groupe de travail, le Forum des droits sur l’internet a mis en place, sur son site internet, un appel à témoignages. Cet appel a permis de recueillir l’avis des salariés et des employeurs sur le télétravail et leurs expériences dans ce domaine.
Mêlant des points de vue très divers, aux tonalités tour à tour techniques, économiques ou encore sociologiques, les témoignages ont confirmé la richesse des problématiques soulevées.
Ils ont porté sur un certain nombre de constats portant sur les avantages du télétravail (1), tout en montrant ses limites (2). De ces constats divers il ressort un point faisant néanmoins l’unanimité (3).
1. Le télétravail comporte un certain nombre d’avantagesLes témoignages ont été nombreux pour montrer que le télétravail comporte un certain nombre d’avantages.
a. Les avantages en termes de qualité de vie
Le télétravail permet une réorganisation de la vie personnelle. Un témoignage précise en effet que » ne voyant plus la nécessité de rester en banlieue parisienne, je me suis établi en province « .
Cette forme de travail engendre également moins de stress et des gains de temps qui se manifestent par une sensation de plus de liberté. Le même témoignage insiste sur le fait que » Fini les bouchons et embouteillages, les heures perdues dans les déplacements, le stress et les énervements; le temps perdu dans la circulation, c’est autant d’heures de travail en plus, ou de temps libre « .
Enfin, le télétravail offre la possibilité de travailler à son rythme : » On est bien plus efficace en travaillant dans ces conditions (télétravail). De plus, si un jour vous avez envie de lever le pied (quand c’est possible), rien ne vous en empêche, mais le lendemain, il faut mettre les bouchées double « . Un autre témoignage précise que l’un des principaux avantages du télétravail est » surtout lié à la possibilité de vivre où bon me semble ; en l’occurrence, je vis en milieu rural et mange avec mon épouse et ma fille tous les jours à midi « .
b. Les avantages en termes de coûts
Le télétravail permet de réaliser des économies tant pour l’employeur que pour le salarié.
Il a été noté que pour l’employeur, le télétravail est peu coûteux et permet plus facilement à des petites structures de rivaliser avec la concurrence. De plus, il semble bien adapté pour des structures de création multimédia. Un témoignage précise ainsi que le télétravail » est peu coûteux puisque les échanges de mail et quelques rendez-vous ponctuels suffisent à bien cadrer un projet. Dans le secteur d’activité lié aux nouvelles technologies, il est difficile d’assumer tous les métiers en interne. Le télétravail nous permet donc de trouver le profil le plus idéal en fonction de nos besoins. Les contrats étant généralement de courte durée (1, 2, 3 mois) « .
Le salarié, de son côté, voit se réduire un certain nombre de coûts. De nombreux témoignages insistent sur le fait que, la mise en télétravail leur a permis de » réaliser des économies (pas de frais de logements, moins de déplacements, conservation du salaire correspondant à l’ancien poste…) « .
c. Les avantages en termes d’aménagement du territoire
Un témoignage note que le télétravail permettrait de maintenir un certain nombre de services dans les territoires, voire de faire des économies d’infrastructures. Même si ce témoignage aborde surtout la problématique par le biais de la fonction publique, les points mentionnés peuvent s’appliquer à toute structure. Il est ainsi précisé que » les fonctionnaires d’origine provinciale répugnent à s’installer à Paris et en région parisienne (difficultés à trouver un logement, vie chère…). Il en résulte un turn-over important dans les services (…) et une perte d’emplois en province qui sont redéployés sur les régions parisienne et PACA. Ce phénomène amplifie encore la désertification de nos campagnes et coûte cher en termes d’équipements sociaux dans les grandes villes. Le télétravail permettrait de maintenir des petites structures là où elles existent traitant en back office des travaux des grandes agglomérations. Que l’on pense à ce que cela pourrait avoir comme conséquences en termes de qualité de vie, d’aménagement du territoire, de flexibilité, d’économies d’infrastructures et d’équipements divers « .
2. Des limites persistent
Un certain nombre de limites au développement du télétravail ont été mises en avant.
a. Des limites en termes d’accessibilité aux technologies
Un point souvent évoqué porte sur la difficulté d’obtenir du haut débit et une interconnexion forfaitaire illimitée quand on télétravaille loin des grandes villes.
Le problème de l’aménagement numérique du territoire est clairement posé : » Le gros problème, c’est que le télétravail nécessite une connexion internet illimité, et de préférence de qualité, surtout dans mon job : webmastering de sites internet, rédacteur, etc. Hélas, la province et la campagne sont dépourvues de connexion haut débit « .
b. Des limites en terme de management
Les témoignages reçus confirment qu’un certain nombre d’employeurs ne seraient pas prêts à ne plus voir quotidiennement leurs collaborateurs et ne sont pas convaincus des potentialités du télétravail. On note ainsi qu’une certaine réticence pour la mise en télétravail peut naturellement apparaître, dans un premier tout au moins, chez le manager. Un témoignage note ainsi » mon employeur, à qui j’ai un peu forcé la main à l’époque, n’avait qu’une crainte : le ressentiment de mes collègues à mon égard. En fait mes collègues ont dans leur ensemble rapidement compris que l’éloignement ne changeait que peu de chose à partir du moment ou le contact permanent (téléphone, mail etc.) est très régulier « . La même personne remarque ainsi que, de façon générale, » les employeurs, pour beaucoup d’entre eux craignent de ne plus avoir le contrôle sur leurs salariés, c’est montrer un manque de confiance énorme « .
Un autre témoignage remarque que » certains managers préfèrent avoir leur équipe sous leurs yeux (je te vois = tu travailles, je ne te vois pas = travailles tu vraiment ?). Et pourtant, de plus en plus de structures sont internationales et par ce fait, les employés doivent communiquer par téléphone ou vidéoconférence (=> quel différence avec un télétravailleur ?) « . Cette remarque appelle une proposition et une interrogation : » Une manière de débloquer les réfractaires pourrait être la mise en place d’indicateurs permettant d’évaluer si le travail a été réalisé. Finalement, être contre le télétravail, est-ce aussi reconnaître qu’on a du mal à évaluer et à planifier le travail de ses collaborateurs ? « .
c. Des limites en termes de liens avec le collectif de travail
Le télétravail suppose une distance avec le collectif de travail qui, d’après les témoignages, peut engendrer du stress, de la frustration et un sentiment d’isolement. Il est ainsi précisé que » les problèmes sont liés au stress dû à une présence bien plus assidue qu’au bureau, ne serait-ce que pour de courtes absences. Il est également un peu frustrant de voir ses collègues constamment en RTT ou en vacances et de devoir finir leur travail sous la pression constante des délais promis au client. L’isolement social est un peu pesant, mais cela permet aussi d’éviter les éventuels conflits… « .
3. Tout le monde ne peut être en télétravail
a. Un point qui fait l’unanimité
D’une manière générale, les témoignages ont clairement montré qu’une idée s’impose : tout le monde ne peut être en télétravail. Cela ne veut pas seulement dire que tous les métiers ne se prêtent pas au télétravail. Cela signifie surtout qu’en l’absence d’une présence continue de la hiérarchie, le télétravailleur doit être motivé et bien organisé. Il est ainsi noté que » Quelqu’un de non motivé ne pourra jamais y arriver, quelqu’un de non organisé non plus, et quelqu’un qui passerait 20 heures devant son écran détruira à coup sur son environnement familial « .
b. Des constats particuliers…
Pour beaucoup, « le télétravail n’est pas une affaire de technique (informatique, téléphone etc.) : les technologies actuelles permettent un confort technique quasi parfait et très facile à mettre en œuvre « .
De même, nombre de témoignages ont noté que « l’isolement n’est pas un problème dans la mesure ou le télétravailleur n’est pas déjà « isolé » « .
Enfin, il semblerait que le risque, souvent cité, » de travailler trop et de ne pas avoir de frontière claire nette le monde professionnel et l’espace privé est uniquement dépendant de la personne, une personne qui ne sait pas dire non au bureau risque de ne pas savoir dire non à distance « .
c. … qui amènent une remarque générale
Ces constats particuliers amènent une remarque générale fondée sur le fait que « l’organisation est le maître mot du télétravail, (…) le fait d’avoir un bureau à la maison entraînera à travailler mieux seulement si nous avons un minimum d’organisation. Par exemple je travaille à la maison mais je n’ai pas de pièce dédiée (tout simplement pas assez de place), donc mon « bureau » est « volant » (2 tréteaux, une planche, deux téléphones et un PC portable). Il n’est pas impossible que si j’avais une pièce dédiée, la tentation de « dépasser » le temps passé à travailler soit plus grande « .
ANNEXE 5
ETUDE DEMANDEE PAR LE FORUM DES DROITS SUR L’INTERNET A LA DARES
|
|
Le télétravail en France : un premier cadrage statistique
Le télétravail à domicile concerne environ 2% des salariés en France, et le télétravail nomade 5%. C’est du moins l’estimation que permet de faire l’Enquête permanente sur les conditions de vie (EPCV-Insee) sur la période 1999-2003. Le télétravail est majoritairement masculin et concerne surtout des salariés très qualifiés (cadres où professions intermédiaires), notamment dans les services aux entreprises. Les télétravailleurs semblent plutôt bien insérés dans leur entreprise, mais leur temps de travail déborde largement sur leur temps familial.
Essayer d’appréhender le télétravail avec les outils de la statistique n’est pas une opération aisée. En effet si le terme de télétravail ne bénéficie pas d’une définition consensuelle chez les spécialistes, c’est évidemment encore moins le cas auprès des travailleurs eux-mêmes. Il est à cet égard peu opérant de poser directement la question » pratiquez-vous le télétravail « [45], du moins dans un contexte national comme celui de la France où ce terme n’est probablement pas compris d’une large fraction de la population, et peut recevoir diverses acceptions de la part de ceux qui pensent le comprendre.
Pour cerner statistiquement la population des » télétravailleurs « , il faut d’abord la délimiter au plan conceptuel, donc définir les critères discriminants du télétravail. Il faut ensuite mobiliser des outils statistiques comportant des informations sur ces critères ou des critères proches.
Nous commencerons par préciser les critères utilisés, puis nous présenterons les principaux résultats d’une première analyse statistique menée sur une source que nous jugeons la seule pertinente aujourd’hui pour la France.
1. Définition et critères du télétravail
La définition retenue par » l’accord cadre sur le télétravail » signé par les partenaires sociaux européens le 16/07/2002 est assez restrictive : » le télétravail est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l’information, dans le cadre d’un contrat ou d’une relation d’emploi, dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière « .
La restriction selon laquelle le travail devrait pouvoir » être réalisé dans les locaux de l’employeur » pose manifestement problème. Elle vise sans doute à écarter des activités » naturellement » délocalisées, comme les activités commerciales ou d’entretien chez les clients. Mais un commercial ou un réparateur qui envoie par Internet à son entreprise le bon de commande ou le rapport d’intervention depuis les locaux du client, n’est probablement pas un télétravailleur selon cette définition, puisqu’il » pourrait » revenir dans son entreprise pour déposer ces documents – même au prix de délais et de coûts de transport importants. Or le développement des TIC réduit de telle façon certains coûts qu’il devient difficile de penser que ce type de tâche » pourrait » être réalisé dans les locaux de l’employeur… De même, les salariés travaillant loin de leur hiérarchie dans des » centres de proximité » installés par leur entreprise près de leur domicile, ne seront pas probablement considérés comme des télétravailleurs par l’accord-cadre, puisqu’ils travaillent dans des locaux de l’employeur.
Selon la définition plus large adoptée par le Forum des droits sur l’Internet, le télétravail salarié[46] est » le travail qui s’effectue, dans le cadre d’un contrat de travail, au domicile ou à distance de l’environnement hiérarchique et de l’équipe du travailleur à l’aide des technologies de l’information et de la communication « [47]. Le Forum des droits sur l’internet distingue quatre formes de télétravail : 1. en réseau au sein de l’entreprise dans des locaux distincts ; 2. dans des locaux partagés par plusieurs entreprises ; 3. nomade ; 4. à domicile.
Dans l’idéal, un questionnement statistique qui viserait à décrire ces populations devrait comporter des questions détaillées sur l’usage professionnel de l’informatique (du téléphone, du fax…): lieu d’utilisation (domicile, établissement appartenant ou non à l’entreprise, lieux multiples…), durée d’utilisation dans les différents lieux, proximité du supérieur hiérarchique, connexion à Internet ou au réseau de l’entreprise.
En pratique aucun questionnaire existant ne fournit ce type d’informations détaillées : les enquêtes de la Dares sur les conditions de travail, par exemple, ne s’intéressaient guère au télétravail, pratique tout à fait rare dans les entreprises dans les années 70-80 (et encore aujourd’hui, on va le voir). L’enquête de 2005 permettra pour la première fois de fournir une évaluation. Sans attendre cette enquête, nous nous appuierons ici sur l’Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages (Enquête PCV, Insee), et plus précisément sur le module de cette enquête réalisé chaque année en octobre, qui comprend un questionnement succinct mais utile sur les conditions de travail, la localisation de l’activité de travail et l’usage de l’informatique (cf. encadré).
2. La mesure du télétravail dans l’Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages (PCV-Insee)
Le module d’octobre de l’enquête PCV est passé auprès d’environ 5500 ménages, où environ 2500 salariés occupés répondent sur leurs conditions de travail. L’échantillon est renouvelé par moitié chaque année. Pour disposer d’un nombre suffisant d’observations afin d’établir des ventilations par CSP et par secteur d’activité, on a empilé cinq enquêtes successives : les 2500 enquêtés de 1999, et les 1250 entrants de 2000, 2001, 2002 et 2003. Les chiffres ici présentés reposent donc sur un échantillon de 6244 salariés interrogés entre 1999 et 2003 : il s’agit donc d’une image du télétravail au tournant du siècle, mais pas une année déterminée. Les échantillons annuels sont d’ailleurs trop petits et les évolutions d’une année à l’autre trop faibles pour qu’on puisse commenter ces dernières.
Quatre questions nous permettront de délimiter une population de » télétravailleurs » :
– Vous arrive-t-il de travailler à domicile ? (1. toujours ou presque ; 2. souvent ; 3. de temps en temps ; 4. rarement ; 5. jamais)
– Travaillez-vous toujours sur le même lieu ? (1. oui, toujours ou presque ; 2. non, vous partagez votre temps entre plusieurs lieux plutôt déterminés ; 3. non, vous avez un lieu de travail de base, mais vous passez la plupart de votre temps de travail ailleurs ; 4. non, vous n’avez aucun lieu de travail déterminé).
– Utilisez-vous dans votre travail un minitel ou un micro-ordinateur ou une machine de traitement de texte ou un terminal relié à un ordinateur ? (1. tous les jours, 2. plusieurs fois par semaine, 3. une fois par semaine, 4. plusieurs fois par mois, 5. une fois par mois, 6. moins d’une fois par mois, 7. ne sait pas la fréquence, 8. jamais ou presque).
– Combien d’heures avez-vous utilisé cet appareil la semaine dernière ?
Pour qu’un salarié soit considéré comme télétravailleur, il faut d’abord qu’il utilise dans son travail les technologies de l’information avec une régularité et une intensité suffisantes : nous avons retenu les salariés qui utilisent l’informatique tous les jours ou plusieurs fois par semaine, et qui signalent un usage supérieur à 5 heures par semaine. On écarte ainsi 64% de l’échantillon.
Il faut ensuite que cet usage de l’informatique se déroule au moins pour partie loin de son responsable hiérarchique ou de son équipe de travail. Ceci nous amène à écarter les personnes répondant travailler » toujours ou presque sur le même lieu » sans que ce lieu soit leur domicile (soit les trois-quarts des gros utilisateurs de l’informatique, c’est-à-dire 27% de l’échantillon).
Certes on écarte ainsi à tort les télétravailleurs des formes 1. (en réseau au sein de l’entreprise dans des locaux distincts) et 2. (dans des locaux partagés par plusieurs entreprises). Mais ces formes de télétravail sont vraisemblablement très minoritaires par rapport au travail à domicile et au travail nomade (ainsi aux USA le télétravail à domicile, alternant ou fixe, représenterait 84% du total[48]).
On définit alors trois types statistiques de télétravail parmi les grands utilisateurs de l’informatique:
– ceux qui travaillent » toujours ou presque » ou » souvent » à leur domicile et qui déclarent travailler » toujours ou presque sur le même lieu « , sont réputés » télétravailleurs fixes à domicile » ;
– ceux qui travaillent » toujours ou presque » ou » souvent » à leur domicile mais signalent d’autres lieux de travail sont réputés » télétravailleurs alternants à domicile » ;
– ceux qui ne travaillent pas souvent à leur domicile mais signalent plusieurs lieux de travail sont réputés » télétravailleurs nomades « .
Remarquons que ces conventions amènent très vraisemblablement à une surestimation du nombre de télétravailleurs. En effet on ne sait pas où les salariés utilisent l’informatique : les nombreux cadres qui emmènent souvent des dossiers à lire à la maison et qui travaillent beaucoup sur ordinateur à leur bureau seront ici comptés à tort parmi les » télétravailleurs alternants à domicile « .
Cette majoration du nombre de télétravailleurs ne concerne pas seulement le télétravail alternant. Le cas des enseignants apparaît à cet égard très particulier : 15% d’entre eux se rangent dans la catégorie du » télétravail fixe à domicile « , 6% dans le » télétravail alternant à domicile » et 5% dans le » télétravail nomade « . Les enseignants, en général fortement utilisateurs de l’informatique, consacrent souvent du temps à domicile pour la préparation des cours ou la correction des copies, ou bien enseignent dans plusieurs établissements, sans qu’on puisse parler de » télétravail « . Sans doute quelques uns des enseignants interrogés pratiquent-ils le télé-enseignement, mais rien ne permet de les repérer, et ils sont certainement très minoritaires[49]. Nous avons donc choisi d’exclure les enseignants de notre décompte du télétravail en France (ce qui réduit de 2 points la proportion de salariés répondant aux critères du télétravail définis ci-dessus).
3. Principaux résultats
Il y aurait 2% de télétravailleurs à domicile et 5% de télétravailleurs nomades parmi les salariés. Sur 22 millions de salariés, notre estimation est qu’au plus 440 000 (soit 2%) peuvent être considérés comme des télétravailleurs à domicile[50].
Rappelons que les » télétravailleurs à domicile » sont ici les salariés qui signalent à la fois utiliser intensivement l’informatique et travailler toujours ou souvent à leur domicile. Environ la moitié d’entre eux (soit 1% des salariés) disent travailler » toujours au même endroit ou presque » : on peut donc supposer qu’il s’agit de leur domicile, et les qualifier de » télétravailleurs fixes à domicile » pour ce qui les concerne. L’autre moitié déclare fréquenter plusieurs lieux de travail différents, ce sont les » télétravailleurs alternants à domicile « .
Chez les non-salariés, la proportion de personnes remplissant les critères ici adoptés pour définir le télétravail à domicile est de 6%, mais il serait sans doute abusif de les qualifier de télétravailleurs dans la mesure où ils n’ont pas de lien de subordination avec un employeur, et où le domicile peut fort naturellement constituer le lieu de travail habituel pour nombre de travailleurs indépendants.
Le » télétravail nomade » concerne quant à lui au plus 1 100 000 salariés (soit 5% des salariés). Il s’agit des salariés grands utilisateurs de l’informatique qui partagent leur temps de travail entre plusieurs lieux, sans travailler beaucoup à leur domicile. Pour les non-salariés, la proportion de personnes concernées est de 4%.
Les télétravailleurs sont surtout des cadres…
Le télétravail concerne essentiellement des salariés très qualifiés : pratiquement aucun ouvrier et une très faible proportion des employés peuvent être considérés comme des télétravailleurs.
Concernant le télétravail à domicile, dans près de la moitié des cas il concerne des ingénieurs ou cadres, et des professions intermédiaires pour un tiers. Ainsi 10% des cadres peuvent être considérés comme des télétravailleurs à domicile (4% fixes, 6% alternants), mais seulement 2% des professions intermédiaires (respectivement 1% et 1%), et moins de 1% des employés.
Le télétravail nomade est lui aussi l’apanage des salariés très qualifiés : près de la moitié de ces télétravailleurs sont des ingénieurs ou cadres, et plus d’un tiers appartiennent à des professions intermédiaires. 20% des cadres font du télétravail nomade, 9% des professions intermédiaires et 3% des employés.
… et des hommes
Les femmes sont minoritaires parmi les télétravailleurs : elles représentent 43% des télétravailleurs fixes à domicile (soit 2 points de moins que leur part dans la population salariée), et seulement 17% des télétravailleurs alternants et 24% des travailleurs nomades. La probabilité qu’une femme soit télétravailleuse à domicile ne dépend pas du fait qu’elle aie des enfants ni du nombre éventuel d’enfants : ceci contredit l’hypothèse parfois avancée, selon laquelle le télétravail serait favorisé par le souhait des femmes de pouvoir mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.
Le télétravail nomade est plutôt réservé aux CDI à temps plein
Le statut de l’emploi – contrat précaire (CDD ou intérim), CDI temps partiel ou CDI temps plein – n’influence pas le recours au travail à domicile ; en revanche les télétravailleurs nomades sont plus souvent en CDI à temps plein (90%) que l’ensemble des salariés (74%). C’est surtout du fait de la rareté des contrats à temps partiel (3% des télétravailleurs nomades sont en CDI à temps partiel contre 13% des salariés).
Les services aux entreprises sont les plus gros utilisateurs
Deux secteurs se distinguent par une utilisation plus intensive du télétravail : le secteur financier (banques et assurances), avec 3% de télétravailleurs à domicile, surtout fixes, et 9% de télétravailleurs nomades ; et surtout les services aux entreprises, qui comptent 4% de télétravailleurs à domicile (plutôt alternants) et 16% de télétravailleurs nomades. Du fait de leur relativement faible proportion de cadres, le BTP, le commerce, les services aux particuliers et les transports sont nettement en retrait ; l’industrie et l’administration se situent dans la moyenne.
Globalement, le secteur public compte un peu moins de télétravail à domicile, puisque seulement 1% de ses salariés y ont recours[51]. Mais toutes choses égales par ailleurs, aucune différence n’apparaît liée au statut public ou privé des emplois, ni pour le télétravail nomade ni pour celui à domicile.
Les seniors plutôt moins concernés par le télétravail nomade
Le recours au télétravail fixe à domicile n’apparaît pas lié à l’âge des personnes. Mais seulement 4% des salariés de 50 ans et plus sont des télétravailleurs nomades (contre 5% pour l’ensemble) ; cette différence, certes faible, est néanmoins significative toutes choses égales par ailleurs.
Des horaires plus souples mais plus longs
Les télétravailleurs ont des horaires plus souples : ainsi, chez les cadres, 57% des télétravailleurs à domicile et 53% des télétravailleurs nomades déterminent librement leurs horaires de travail, contre 35% des cadres ordinaires. Mais cette liberté se paie par d’importants débordements du travail sur le temps familial : les télétravailleurs sont beaucoup plus nombreux à signaler travailler la nuit, le samedi ou le dimanche. Les plus touchés sont les télétravailleurs alternants à domicile : 20% d’entre eux signalent travailler » habituellement » la nuit[52] (contre 10% des autres salariés). Alors que 70% des salariés ordinaires ne travaillent jamais la nuit, c’est le cas de seulement 30% des télétravailleurs alternants (58% pour les mobiles et 60% pour les fixes).
Alors que seulement 11% des cadres déclarent travailler habituellement le samedi et 3% le dimanche, ces proportions s’élèvent à 29% et 20% pour les télétravailleurs alternants.
Ces conditions de travail sont-elles mal ressenties par les personnes ? Le questionnaire ne comporte pas de question directe sur la satisfaction au travail. Remarquons néanmoins que 8 à 9% des télétravailleurs évoquent un risque de démission au cours des douze prochains mois, contre seulement 4% des salariés ordinaires[53].
Une insertion plutôt bonne dans leur emploi
Les télétravailleurs n’apparaissent cependant pas marginaux par rapport à leur entreprise ou à leur collectif de travail. On a vu qu’ils étaient plus souvent en CDI à temps plein ; de même ils sont plus nombreux à avoir reçu une formation au cours des 12 derniers mois (par exemple, 47% des nomades contre 28% des salariés ordinaires). Certes, cela s’explique surtout par le fait que leur niveau élevé de qualification les favorise dans l’accès à la formation, mais pas seulement : le lien résiste à une analyse toutes choses égales par ailleurs. Les télétravailleurs déclarent aussi souvent que les salariés ordinaires pouvoir espérer une promotion dans leur entreprise. Ils ne souffrent pas non plus d’un isolement social particulier, au contraire : les télétravailleurs alternants signalent plus souvent (63%) fréquenter des collègues hors du travail que les autres salariés (52%)[54].
Trois formes contrastées de télétravail
Au final, les trois formes de télétravail distinguées a priori semblent bien renvoyer à des situations assez contrastées. Le télétravailleur à domicile alternant évoque, de par ses caractéristiques, la figure de l’homme cadre et surmené, fortement investi dans son travail, lequel déborde largement sur sa vie personnelle. Le télétravailleur fixe à domicile est moins systématiquement un homme jeune, mais il (elle) est aussi qualifié(e) et a des horaires presque aussi atypiques que l’alternant. Le télétravailleur nomade, lui aussi plutôt jeune et masculin, occupe souvent une fonction spécifique (commerciale ou technique) qui l’astreint à travailler dans les locaux des clients de son entreprise ; mais son travail n’envahit pas autant sa vie que pour les catégories précédentes. La question du temps de travail et de son empiètement sur la vie personnelle semble néanmoins au cœur des caractéristiques du télétravail.
Tableau 1
Le télétravail à partir de l’enquête permanente sur les conditions de vie
|
salariés gros utilisateurs de l’informatique
|
| Travaillent toujours ou souvent à leur domicile |
Travaillent toujours ou presque sur le même lieu |
Télétravailleurs fixes à domicile (1%) |
| Ont plusieurs lieux de travail différents |
Télétravailleurs alternants à domicile (1%) |
| Travaillent peu ou jamais à leur domicile |
Ont plusieurs lieux de travail différents |
Télétravailleurs nomades (5%) |
Source : EPCV 1999-2002, Insee, calculs Dares
Tableau 2
Les caractéristiques spécifiques des télétravailleurs
| Formes de télétravail : |
Fixe à domicile |
Alternant à domicile |
Nomade |
| Femmes |
|
– – |
– – |
| Seniors |
|
– |
– – |
| CDI temps plein |
|
|
+ |
| Services aux entreprises |
|
|
++ |
| Banques et assurances |
+ |
|
|
| Ingénieurs et cadres |
++ |
++ |
++ |
Source : Insee, Enquêtes PCV 1999-2003, calculs Dares
Note de lecture : les femmes pratiquent significativement moins souvent le télétravail alternant à domicile, toutes choses égales par ailleurs (modélisation Logit; ++ ou – – (resp. + ou -) indique un lien significatif à 1%, (resp. 10%); une case vide indique une absence de lien significatif).
Tableau 3
Les conditions de travail et d’emploi des télétravailleurs
| Formes de télétravail : |
Fixe à domicile |
Alternant à domicile |
Nomade |
| Horaires librement déterminés |
++ |
++ |
++ |
| Travaille la nuit |
+ |
++ |
|
| Travaille le week-end |
++ |
++ |
+ |
| Fréquente des collègues hors du travail |
|
+ |
|
| A suivi une formation au cours des 12 derniers mois |
+ |
|
+ |
Note de lecture : les télétravailleurs fixes à domicile sont significativement plus souvent libres de déterminer leurs horaires que les autres travailleurs, toutes choses égales par ailleurs (modélisation Logit ; ++ ou – – (resp. + ou -) indique un lien significatif à 1%, (resp. 10%); une case vide indique une absence de lien significatif).
Source : Insee, Enquêtes PCV 1999-2003, calculs Dares
Tableaux détaillés
Tableau 4
Le télétravail selon les secteurs d’activité
| Formes de télétravail : |
Fixe à domicile |
Alternant à domicile |
Nomade |
| Industrie manufacturière |
1,0% |
1,4% |
6,0% |
| Bâtiment – TP |
0,6% |
0,2% |
3,0% |
| Transports – télécom. |
0,3% |
0,3% |
4,6% |
| Commerce |
0% |
0,9% |
3,5% |
| Banques et Assurances |
2,9% |
1,4% |
9,4% |
| Services aux entreprises |
1,9% |
2,9% |
15,7% |
| Services aux particuliers |
0,9% |
0,8% |
1,8% |
| Ensemble |
0,9% |
1,1% |
5,4% |
Source : Insee, Enquêtes PCV 1999-2003, calculs Dares
Tableau 5
Le télétravail selon le sexe et la catégorie socio-professionnelle
| Formes de télétravail : |
Fixe à domicile |
Alternant à domicile |
Nomade |
| Ingénieurs et Cadres |
3,7% |
6,0% |
20,1% |
| Professions intermédiaires |
1,1% |
1,2% |
9,0% |
| Employés |
0,6% |
0,3% |
2,7% |
| Ouvriers |
0% |
0,1% |
0,6% |
| Ensemble |
0,9% |
1,1% |
5,4% |
| Hommes |
1,0% |
1,7% |
7,5% |
| Femmes |
0,9% |
0,4% |
2,8% |
Source : Insee, Enquêtes PCV 1999-2003, calculs Dares
Tableau 6
Quelques caractéristiques du travail et de l’emploi des télétravailleurs
| Formes de télétravail : |
Fixe à domicile |
Alternant à domicile |
Nomade |
Tous salariés |
| Maîtrise des horaires |
53% |
61% |
33% |
10% |
| Travail de nuit (occasionnel ou régulier) |
39% |
69% |
42% |
30% |
| Travail le week-end (occasionnel ou régulier) |
73% |
79% |
61% |
56% |
| Contrat précaire |
10% |
10% |
7% |
13% |
| Possibilité de promotion |
45% |
56% |
56% |
39% |
| Formation au cours des 12 mois |
43% |
40% |
47% |
28% |
| Rencontre collègues hors du travail |
51% |
63% |
54% |
52% |
| Risque de démission dans les 12 mois |
7% |
8% |
7% |
3% |
Source : Insee, Enquêtes PCV 1999-2003, calculs Dares
ANNEXE 6
ACCORD-CADRE EUROPEEN SUR LE TELETRAVAIL
|
|
Consulter l’accord-cadre
[1] L’accord-cadre européen sur le télétravail a été signé le 16 juillet 2002 par les partenaires sociaux européens – CES (Confédération européenne des syndicats de salariés), UNICE/UEAPME (Union des Confédérations de l’Industrie et des Employeurs d’Europe), CEEP (Centres Européen des Entreprises à Participation Publique et des Entreprises d’Intérêt Economique Général).
[2] Article 2 » Définition et champ d’application » de l’accord-cadre européen sur le télétravail.
[3] La Dares s’est appuyée sur » l’Enquête permanente sur les conditions de vie (EPCV-Insee) » sur la période 1999-2003 Cette enquête, réalisée chaque année en octobre, comprend un questionnement utile sur les conditions de travail, la localisation de l’activité de travail et l’usage de l’informatique.
[4] L’étude SIBIS (Statistical Indicators Benchmarking the Information Society) a montré qu’en 2003 la France comptait environ 6% de télétravailleurs (4% de télétravail à domicile et 2% de télétravail nomade). Il est intéressant de noter que ce pourcentage est établi à partir des données portant sur les télétravailleurs à domicile et les télétravailleurs nomades.
[5] En 2001, l’étude commandée par l’Union européenne (Eurobarometer) estimait que 5,6% des salariés français étaient en situation de télétravail.
[6] C’est à dire après 22h00 et avant 6h00; il ne s’agit pas de travail posté en horaires alternants, puisque aucun télétravailleur ne déclare faire de tels horaires.
[7] Sur 150.000 agents, 8.000 sont en situation de télétravail.
[8] En 1999, 1500 salariés utilisaient cette organisation du travail en fréquentant régulièrement un ou plusieurs des 8 sites de proximité. Fin 2003, 3500 salariés ont passé en moyenne 1,5 jour par semaine dans ces sites. De façon globale, il est estimé que, sur les 13.100 salariés d’IBM France, 5000 ont des fonctions compatibles avec la mobilité.
[9] Il est estimé que, sur des effectifs globaux de 130.000 salariés en France, environ 17.000 (13.000 cadres et 4.000 non cadres) sont en situation de télétravail. France Télécom couvre toutes les formes de travail à distance par le biais des TIC (travail dans des bureaux de passage, à domicile ou sur les chantiers). Les cadres télétravaillent majoritairement de façon alternée (en moyenne un à deux jours par semaine à domicile). Les techniciens non cadres travaillent en mobilité client/chantier à l’aide d’outils de type PDA (Personal Digital Assistant ou Assistant numérique personnel) ou téléphone WAP.
[10] Par exemple : » Protocole d’accord sur le télétravail à domicile ou dans tout autre local à usage d’habitation » mis en place par le rectorat de l’Académie de Bordeaux dès 1994.
[11] Les Comités Interministériels pour la Société de l’information (CISI) du 10 juillet 2003 et d’Aménagement et de Développement du Territoire (CIADT) du 3 septembre 2003 ont décidé le lancement d’un appel à projets » TélécentresTéléactivités « . Cet appel à projets a été confirmé lors du CIADT du 14 septembre 2004. Il sera piloté par la DATAR.
[12] Sondage UK, Labour Force Survey, printemps 2004. Parmi les 1.930.000 télétravailleurs, 440.000 travaillent au domicile (soit 1,6% des salariés britanniques).
[13] www.cso.ie/publications/labour/qnhsteleworking.pdf
[14] http://www.dti.gov.uk/er/individual/telework.pdf
[15] L’article 116 de la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques de 2001, demande aux entreprises cotées de droit français de fournir des informations sociales et environnementales dans leurs rapports annuels. Son décret d’application du 20 février 2002 énumère les critères sociaux et environnementaux, qui doivent être fournis. On peut distinguer un premier groupe de 32 informations » sociales internes » (effectifs, formation, hygiène, sécurité, parité, handicapés etc.), un second portant sur l’impact territorial de l’activité (filiales, sous-traitants, lien au territoire, soit 8 rubriques) et un troisième portant sur l’environnement (28 rubriques).
[16] En cas d’abus de confiance, le salarié risque, lui aussi, d’être condamné. C’est ce qu’a encore récemment rappelé la Cour de cassation qui a confirmé une décision ayant condamné un salarié pour avoir détourné son ordinateur et la connexion internet professionnelle de l’usage pour lequel ils avaient été mis à sa disposition (Cass. Crim., 19 mai 2004 : Juris-Data n° 2004-024120).
[17] » Le Marché Français de la Mobilité – Bilan 2003 – Perspectives 2006 « , étude IDC France, septembre 2004.
[18] A savoir les PC portables, téléphones mobiles, PDA, Tablet PC ainsi que, pour les données mobiles le WIFI ou le GPRS.
[19] » Usages business des technologies sans fil. Maturité des usages, bilan des projets » et » Le marché de la mobilité en France et à l’international. Modèles économiques, technologies et standards « , rapports Cigref, septembre 2004.
[20] Une attaque par déni de service (denial of service), est une technique consistant à envoyer sur un site internet de multiples requêtes simultanées afin de saturer le serveur. Cet envoi d’un trop grand nombre de données peut entraîner un très fort ralentissement des échanges voire une panne du système.
[21] Le flooding ( » inondation « ) est un type particulier d’attaque par déni de service qui consiste à saturer les accès au serveur par » inondation » du système c’est-à-dire par transmissions régulières, sur les équipements frontaux du système de traitement, de paquets de données non conformes (taille trop importante des paquets d’information) qui perturbent le fonctionnement des équipements et peuvent provoquer leur panne.
[22] Le spoofing ( » usurpation « ) est une technique dite d’ » usurpation » ou de » mystification » sur un réseau pouvant permettre la multiplication des actions à l’insu de l’utilisateur légitime. Il existe deux sortes d’actions de » spoofing » : l' » address spoofing » (appelé aussi » IP spoofing « ) et le » web spoofing « . L’address spoofing consiste à se faire passer pour quelqu’un d’autre, en utilisant son adresse sur le réseau. Le » web spoofing » consiste à remplacer un site par une version pirate du même site.
[23] Un réseau privé virtuel (VPN, Virtual Private Network) consiste en la mise en place, au sein d’une infrastructure non sécurisée comme internet, d’un sous-réseau privé par le biais de connexions sécurisées.
[24] Art. L. 411-1 du Code de la sécurité sociale : » Est considéré comme accident du travail, quelqu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises « .
[25] Cass. Soc. 19 juillet 2001, Bull. Civ. V. n° 285 (2 arrêts). Dans ces deux affaires les salariés en mission ont eu un malaise dans leur chambre d’hôtel. La Cour de Cassation a retenu la présomption d’imputabilité au travail de l’accident de santé dans les deux affaires.
[26] La CNAMTS recense 1,5 million d’accident du travail par an dont 750.000 sont sans arrêt de travail et 4% occasionnent des séquelles indemnisables. Par ailleurs, les accidents liés au travail à domicile semblent rares (49 déclarations d’accidents à domicile en 2002).
[27] Article 6 du décret n° 91-451 du 14 mai 1991.
[28] » La cybersurveillance sur les lieux de travail « . Rapport présenté par Hubert BOUCHET, vice-président délégué de la CNIL et adopté par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en séance plénière du 5 février 2002. Le Rapport a été mis à jour à la suite de l’examen d’un rapport d’étape en séance plénière du 18 décembre 2003.
[29] Art. L. 432-2-1 du code du travail : » Le comité d’entreprise est informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci. Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés « .
[30] Article 6 » Vie privée » de l’accord-cadre européen sur le télétravail : » Si un moyen de surveillance est mis en place, il doit être proportionné à l’objectif « .
[31] Art. L. 120-2 du code du travail : » Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché « .
[32] Article 6 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
[33] Article 7 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
[34] 31° de l’article 81 du code général des impôts. La remise gracieuse devait toutefois intervenir dans le cadre d’un accord conclu entre l’entreprise et ses salariés au plus tard le 31 janvier 2002. Le dispositif dérogatoire d’exonération a été prorogé ; il est désormais possible de conclure un accord jusqu’au 31 décembre 2005.
[35] 11-1° de l’article 39 du code général des impôts.
[36] L’article L.432-2 du code du travail prévoit que » le comité d’entreprise est informé et consulté préalablement à tout projet important d’introduction de nouvelles technologies lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir des conséquences sur l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel « .
[37] Cf. Art 3 de l’accord-cadre : Caractère volontaire ( » Le télétravail est volontaire pour le travailleur et l’employeur concernés « ).
[38] Cass.Soc., 2 octobre 2001, Bull. V n°292.
[39] Art. 3, Caractère volontaire : » Le télétravail peut faire partie du descriptif initial du poste du travailleur, ou on peut s’y engager volontairement par la suite « .
[40] Art.3 : » Si le télétravail ne fait pas partie du descriptif initial du poste, la décision de passer au télétravail est réversible par accord individuel et/ou collectif. La réversibilité peut impliquer un retour au travail dans les locaux de l’employeur à la demande du travailleur ou à celle de l’employeur. Les modalités de cette réversibilité sont établies par accord individuel et/ou collectif « .
[41] Article L. 212-15-3 du code du travail.
[42] Cass. Soc., 22 mai 2001, Société Expertises Galtié c/ M. Farrouilh, Bull. civ., V, n° 180, p. 142.
[43] La directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993, » Concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail » exige une période minimale de repos de 11h00 consécutives chaque jour. Par ailleurs, l’article L. 220-1 du code du travail instaure en faveur de l’ensemble des salariés un droit au repos quotidien de 11 heures consécutives. Si le texte autorise des dérogations à cette règle, ce n’est que de façon limitée et dans des hypothèses bien spécifiques. Le texte prévoit deux types de dérogations à cette règle : » […] Une convention ou un accord collectif étendu peut déroger aux dispositions de l’alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées. Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d’accord collectif étendu, et en cas de travaux urgents en raison d’un accident ou d’une menace d’accident ou de surcroît exceptionnel d’activité ».
[44] L’article L. 212-15-3 II du code du travail concerne les conventions de forfaits en heures et en jours et traite du cas des salariés ayant la qualité de cadre ainsi que des » salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées « .
[45] L’Enquête européenne sur les conditions de travail de 2000 (Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de travail) pose une question sur le télétravail (« votre emploi principal vous amène-t-il à télétravailler depuis votre domicile avec un micro-ordinateur ? « ), où 4% des 1500 personnes enquêtées pour la France (soit 60 personnes) répondent positivement, sans que le terme télétravail n’ait été défini par l’enquêteur. La faible taille de l’échantillon et le flou de la question ne permettent pas de s’appuyer utilement sur cette enquête. L’enquête Eurobarometer pose une question un peu plus précise (les télétravailleurs salariés sont définis comme » accomplissant leur travail, en tout ou en partie, en dehors de leur lieu normal d’activité, généralement chez eux, en utilisant les technologies de l’information et de la communication « ) : 6% des actifs répondent » régulièrement » et 7% » occasionnellement « . Là encore, la faible taille de l’échantillon (1000 personnes de 15 ans et plus, dont des inactifs), empêche toute exploitation plus fine. Enfin l’enquête SIBIS-Empirica (2003) utilise un questionnaire assez précis, permettant de distinguer le télétravail à domicile et le travail mobile (voir http://www.empirica.biz/sibis/statistics/data). A nouveau la très faible taille de l’échantillon (500 personnes) ne permet d’attribuer qu’une valeur indicative aux résultats pour la France (4% de télétravail à domicile et 2% de télétravail mobile).
[46] On ne s’intéressera pas ici au travail non salarié, pour des raisons théoriques (toute prestation commerciale pouvant être fournie sous une forme électronique est susceptible d’être qualifiée de télétravail, ce qui élargit manifestement à l’excès le périmètre du concept) et pratiques (cette note vise à éclairer des discussions entre représentants des employeurs et des salariés).
[47] Forum des droits sur l’Internet, rapport Le télétravail en France, décembre 2004.
[48] J. Lisboa, Etude sur le télétravail en Europe et aux Etats-Unis, juillet 2002, http://www.aftt.asso.fr/publi/Etude%20T%E91%E9travail.htm
[49] La part de marché du secteur privé est vraisemblablement beaucoup plus élevée dans le télé-enseignement que dans l’enseignement classique ; or les » télétravailleurs enseignants » sont encore plus souvent des fonctionnaires (à 90%) que les enseignants classiques (86%), ce qui renforce les doutes sur la réalité de leur télétravail.
[50] Il importe de remarquer que la faiblesse de ces effectifs rend leur estimation précise assez délicate.
[51] Il en irait différemment si l’on incluait les enseignants parmi les télétravailleurs.
[52] C’est à dire » après 22 h et avant 6 h » ; il ne s’agit pas de travail posté en horaires alternants, puisque aucun télétravailleur ne déclare faire de tels horaires.
[53] L’écart n’est statistiquement significatif que pour les télétravailleurs nomades.
[54] Ces personnes répondent rencontrer » souvent » ou » de temps en temps » » des collègues ou des relations de travail en dehors de vos occupations professionnelles « .